


Clin d'œil souriant 😉
Amis curieux et passionnés de l'orgue !
Régulièrement alimentée, cette rubrique vous réserve des SURPRISES.
Insolites, elles ont été dénichées dans les domaines les plus variés
dont l'orgue est le trait d'union, pour votre bonheur.
Vous aurez le plaisir de lire en cliquant sur le numéro correspondant :
• 16. Passacaille et Fugue de J. S. Bach. De l'orgue au mimodrame
• 15. Que d'orgues ! Que d'Orgues ! La démesure du baron de l'Espée et l'orgue du Sacré-Cœur
• 14. L'orgue de la Grotte de Téthys et les chants d'oiseaux
• 13. L’Orgue de papier
• 12. William Herschel (1738-1822). L’organiste qui a repoussé les limites du ciel
• 11. L’orgue de Pauline et sa singulière destinée
• 10. Jouer pour déguster : de l’orgue à saveurs au pianocktail
• 9. Siffler est-ce jouer ? Le Calliope ou l’orgue à vapeur
• 8. Souffler n’est pas jouer. Vraiment ?
• 7. Monsieur ré-dièze et Mademoiselle mi-bémol
• 6 Estampes, musique et orgue
• 5. Le facteur d’orgues Aloys Mooser : « L’homme au chien noir et aux macarons »
• 4. Un orgue au creux d’une main
• 3. L’Orgue du Stade, ou l’Orgue, dieu des stades ?
• 2. Paul et Gertrud Hindemith réunis à l’orgue
• 1. Harmonie du monde naissant
Les personnes qui ont aimablement contribué à enrichir cette rubrique sont nommément
remerciées à la page "Sources et remerciements" des Annexes.
« PASSACAILLE ET FUGUE » DE J. S. BACH
DE L'ORGUE AU MIMODRAME

Jean-Sébastien Bach
(1685 - 1750)
par Elias Gottlob Haussmann
(2e version du portrait de 1746 en 1748)
© Elias Gottlob Haussmann,
Public domain, via Wikimedia Commons
Une « composition colossale et sublime » écrivait Gilles Cantagrel en 1991, pour qualifier la « Passacaille et fugue » en ut mineur BWV 582 que Jean Sébastien Bach a composée pour deux claviers et pédalier dans sa jeunesse, interprétée couramment à l’orgue.
Savez-vous que cette œuvre, transcrite pour orchestre par O. Respighi, a été choisie en 1946 pour être la partie musicale du mimodrame de Jean Cocteau « Le Jeune Homme et la Mort » et, qui plus est, seulement deux jours avant la première représentation par les Ballets des Champs-Élysées ? Les danseurs avaient dû répéter sur une musique de jazz, à laquelle fut substituée au dernier moment celle de Bach arrangée pour orchestre. Ainsi fut mis en scène le « mystère du synchronisme accidentel » cher à J. Cocteau…

Jean Cocteau
en 1923
(1889 - 1963)
Photo de l'Agence Meurisse
Gallica.bnf.fr/BNF
LA PASSACAILLE, UNE ŒUVRE DONT L'HISTOIRE EST MÉCONNUE
Le manuscrit autographe de cette œuvre est perdu. Quant à la première publication connue, elle date de 1834 chez Dunst à Francfort-s/Main.
En l’absence de chronologie des œuvres de jeunesse de Bach, la date et les circonstances de la composition de la « Passacaille et fugue » ne peuvent qu’être soumises à des hypothèses. Il a été longtemps admis que cette œuvre datait des années de Bach à Weimar (1708-1717), et de préférence vers 1716-1717 (d’après Alberto Basso, Marie-Claire Alain, Gilles Cantagrel …).
Plus récemment, l’hypothèse d’une composition antérieure, proposée en particulier par le musicologue allemand Christoph Wolff, est ainsi argumentée : Bach, organiste à la Neuekirche [1] (Église Neuve) d’Arnstadt depuis 1703, avait effectué pendant l’hiver 1705-06 un voyage à Lübeck où il avait rencontré le grand Dietrich Buxtehude (1637 - 1707), organiste de l’église Sainte-Marie. Sur la route du retour, Jean Sébastien n’avait pas manqué de passer par Hambourg pour saluer son ancien maître Johann Adam Reinken (1623 - 1722), organiste de l’église Sainte-Catherine ; quand il était étudiant à Lünebourg de 1700 à 1703, il allait écouter Reinken à Hambourg, et bénéficiait de ses conseils.
[1] Depuis 1935, cette église s’appelle « Bachkirche » (Église Bach)
ARNSTADT

Chevet de l'église d'Arnstadt (Bachkirche)
où J. S. Bach a obtenu la charge d'organiste en 1703, à l'âge de 18 ans, pour jouer le nouvel orgue qui venait d'être achevé par le facteur Johann Friedrich Wender.
© SchiDD, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
_03_edited.jpg)
Orgue Wender de la Bachkirche d'Arnstadt, restauré en 1997 à l'identique de l'original,
avec son buffet, restauré dans l'état de 1703
L'église possède un second orgue Steinmeyer non apparent, pour le répertoire romantique
© Thomas Hummel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Ce serait après son retour à Arnstadt, en 1706 ou quelque temps après, que Bach aurait composé la « Passacaille et fugue » afin de rendre hommage tant à Buxtehude (lui-même auteur d’une passacaille pour orgue [1] ainsi que d’autres œuvres fondées sur un ostinato), qu’à Reinken qui l’avait initié à la technique de la fugue par permutation.
Selon cette hypothèse, le jeune Bach aurait fait preuve d’une maturité exceptionnelle, en composant une telle œuvre.
[1] Œuvre cataloguée BuxWV 161.
.jpg)
Musizierende Gesellschaft (Assemblée de Musiciens)
par Johannes Voorhout, daté de 1674
Museum für Hamburgische Geschichte
© Johannes Voorhout, Public domain, via Wikimedia Commons
Sur cette toile, le claveciniste est Johann Adam Reinken et le joueur de viole de gambe à gauche du tableau serait Dietrich Buxtehude.
La partition posée sur les genoux de l'homme à côté du joueur de luth comporte d'ailleurs une dédicace à Reinken et à son ami Dietrich Buxtehude
DE LA BASSE OBSTINÉE DE LA PASSACAILLE À LA FUGUE
Une passacaille, mot venant de l’espagnol (de pasar, passer et calle, rue) désigne à l’origine une pièce au caractère répétitif, destinée à être chantée ou jouée dans les rues. On considère que son apparition remonte au XVIIe siècle, sans doute en Espagne, d’où elle se répandit en Italie. Elle devint ensuite une danse à trois temps, au mouvement lent, comportant des variations sur un motif mélodique ou rythmique qualifié d’ostinato, c’est-à-dire répété obstinément. À ce titre, la passacaille est proche de la chaconne (ou chacone [1]).
[1] Les deux orthographes sont admises.

Livre d'Orgue d'André Raison
Paris, 1688
Le thème de la passacaille de J. S. Bach est inspiré du Christe -Trio en passacaille (en sol mineur) de la Messe de Deuziesme Ton de l’organiste français André Raison (1650 ? – 1719) [1]. Se présentant comme un lamento, il comporte huit mesures.
[1] André Raison était l’un des plus grands organistes du règne de Louis XIV. La Messe du Deuziesme ton a été publiée dans le Livre d’orgue (Paris, 1688), le Christe se trouve p. 26. A. Raison aurait tiré ce thème de l’antienne pour la Communion Acceptabis sacrificium (Tunc acceptabis sacrificium justitiae : alors tu accepteras un juste sacrifice), Psaume 50 de la Vulgate.
Cliquer pour télécharger le Christe-Trio en passacaille de la messe d'André Raison

Thème de la passacaille BWV 582 de Jean Sébastien Bach
Ce thème est répété vingt et une fois car, après une exposition au pédalier seul, il est réexposé successivement vingt fois au cours de ce qu’on appelle les « variations ». Présenté seize fois à la basse, il ne passe que brièvement dans les voix supérieures, lors des variations 11 à 15. L’ensemble représente 168 mesures.
La fugue qui suit, désignée par thema fugatum (thème fugué) par les premiers éditeurs, est étroitement associée à la passacaille. Le sujet, qui apparaît à douze reprises diversement modulé, correspond aux quatre premières mesures du thème et est combiné à deux contre-sujets. La première note du sujet, lors de son exposition initiale, est une des notes du dernier accord de la passacaille. Quant au premier contre-sujet, il est élaboré à partir de la seconde partie du thème. Autant d’éléments qui conduisent certains à considérer la fugue comme une longue vingt-et-unième variation qui prolonge la passacaille. C’est sans doute pour cette raison qu’on limite souvent le titre de l’ensemble à « Passacaille », comme ce sera fait dorénavant dans ce texte. La fugue comptant 124 mesures, la totalité de l’œuvre comporte 292 mesures et dure de l’ordre de 13 à 15 minutes.
Certains, soulignant la récurrence du nombre 3 [mesure à 3 temps, 3 bémols à la clé, 21 et 12 (multiples de trois) répétitions du thème], ont considéré que Bach avait souhaité dédier cette composition à la Trinité. Quant au nombre 21, il est également avancé qu’il rappellerait la date de naissance de J. S. Bach, 21 mars 1685.
De nombreuses interprétations sont disponibles sur YouTube. Je vous propose d’écouter celle d’Olivier Latry, le dimanche 16 juin 2024, à l’orgue de l'église de Crèvecœur-le-Grand (60) :
En outre, l’ingéniosité de la composition où Bach va jusqu’à superposer cinq voix, a été visualisée en couleurs par le compositeur et ingénieur américain Stephen Malinowski. Cette réalisation constitue un complément intéressant à l’écoute de l’œuvre.

Stephen Malinowski
LA TRANSCRIPTION ORCHESTRALE D'OTTORINO RESPIGHI
De nombreuses transcriptions de la Passacaille ont été réalisées, en particulier pour orchestre. Parmi leurs auteurs, on peut citer Camille Saint-Saëns, Leopold Stokowski, Ottorino Respighi, Eugene Ormandy, Andrew Davis, etc.
En ce qui concerne la transcription due au compositeur et chef d’orchestre italien O. Respighi, elle résulte d’une commande passée par Arturo Toscanini en 1930. Une dizaine de jours a suffi à Respighi pour réaliser cet arrangement [1] qui a été créé au Carnegie Hall de New York le 16 avril 1930 sous la direction de son commanditaire.
Cette transcription, éloignée de la conception de J. S. Bach dans l’œuvre originale, en est une interprétation romantique qui accentue la densité de la polyphonie, rajoute des ornements, enjolive et théâtralise la composition. De forts contrastes sonores dramatisent le discours. La personnalité de Toscanini n’est sans doute pas étrangère au parti pris pour cette transcription.
[1] Œuvre cataloguée P169 par Potito Pedarra, musicologue italien, en 1985.
_edited.jpg)
Ottorino Respighi (1879-1936). Photo by Ghitta Carell, 1936.
© Archivio Storico Ricordi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Pour écouter la transcription pour orchestre de la Passacaille par O. Respighi
par le Royal Philarmonic Orchestra
LA PASSACAILLE DE BACH, UNE MUSIQUE DESTINÉE À
LE JEUNE HOMME ET LA MORT ?
La principale adaptation de la Passacaille de J. S. Bach à des œuvres scéniques ou filmées est certainement celle destinée au « ballet » Le Jeune Homme et la Mort, qui mérite maintenant toute notre attention.
Création au Théâtre des Champs-Élysées en 1946
Le Jeune Homme et la Mort a été conçu par Jean Cocteau en 1946 pour les Ballets des Champs-Élysées, compagnie fondée l’année précédente par Roland Petit et Jeanine Charrat. Roland Petit, alors âgé de 22 ans, en réalise la chorégraphie en étroite collaboration avec son auteur et avec le danseur Jean Babilée à qui il réserve la vedette. L’œuvre est créée le 25 juin 1946 au Théâtre des Champs-Élysées. Le spectacle remporte un très vif succès en raison de son caractère novateur. Le Jeune Homme et la Mort est, de fait, reconnu comme un des chefs-d’œuvre de la danse du XXe siècle.

Roland Petit
© Getty-Bettmann
Comme l’indique le titre de Cocteau, le sujet est tragique. Il est traité en quatre scènes dont un résumé, accompagné de dessins, en a été donné dans la Revue Art et Style d’octobre 1946.
L’argument de chacune de scènes est simple : (1) un jeune artiste peintre, portant une salopette maculée de peinture et un bracelet montre, attend la jeune fille qu’il aime dans son atelier ; (2) elle arrive, vêtue d’une courte robe jaune [1] et portant des gants noirs, l’insulte, le malmène et repart ; (3) en proie à la colère et au désespoir, le jeune homme se pend ; (4) dans un climat irréel, on est transporté sur les toits, de nuit ; arrive une femme en robe de bal et capuchon rouge, portant un masque de squelette ; elle met le masque au jeune homme qui s’est dégagé du nœud coulant ; lorsqu’elle abaisse son capuchon, c’est la jeune fille en jaune qui apparaît et dirige le garçon vers sa disparition.
Certains des décors imaginés par Cocteau ont été empruntés au cinéma par le décorateur Georges Wakhevitch. L'atelier triangulaire est miséreux, meublé d’un lit en fer, d’une table banale et de quelques chaises en bois. Un pilier métallique central porte une potence.
[1] J. Cocteau écrit précisément dans le livret : « Entre une jeune fille brune, élégante, sportive, sans chapeau, en petite robe jaune pâle, très courte (jaune Gradiva) et gants noirs. » Gradiva est l’héroïne d’une nouvelle publiée en 1903 par l’écrivain allemand Wilhelm Jensen intitulée « Gradiva. Ein Pompejanisches phantasiestück ». Nul doute que cette héroïne, présentée par son auteur comme une jeune élégante portant une robe jaune à plis, a dû exercer une influence sur l’univers mental de J. Cocteau. S. Freud s’est emparé, en 1907, de ce personnage pour développer et publier une interprétation psychanalytique du texte. Notons également que Gradiva est la forme féminine de Gradivus, surnom donné au dieu Mars.



Dessins de Jean Cocteau
parus dans le Revue Art et Style, n°5, octobre 1946
Le jeune homme, incarné par le danseur Jean Babilée (1923- 2014), a pour partenaire Nathalie Philippart. J. Babilée interprétera ce rôle plus de deux cents fois, disant à son sujet : « Le jeune homme, c’était moi. Tout était d’une extrême facilité. J’avais un corps qui faisait exactement tout ce que je désirais, une énergie qui obéissait à mes envies et la musique. C’était ma vie que je dansais » [1]
[1] https://www.dansesaveclaplume.com/17120/en-coulisse/deces-de-jean-babilee-leternel-jeune-homme/
_edited.jpg)
J. Babilée
.jpg)
J. Babilée et N. Philippart
Photos du ballet "Le jeune Homme et la Mort" (version de 1946)
parues dans Paris-Théâtre, n°89, octobre 1954
_edited.jpg)
J. Babilée (au centre) et J. Cocteau (à droite)
pendant une répétition

J. Babilée et N. Philippart
Scène 4 sur les toits
Pour la chorégraphie, Roland Petit doit concrétiser le dessein de Jean Cocteau. Il n’en a connaissance que par leurs échanges verbaux car le poète n’a développé le livret du « ballet » qu’en 1947, après les premières représentations, dans son ouvrage La Difficulté d’être [1] où il précise :
« Le Jeune Homme et la Mort, est-ce un ballet ? Non, c’est un mimodrame où la pantomime exagère son style jusqu’à celui de la danse. C’est une pièce muette où je m’efforce de communiquer aux gestes le relief des mots et des cris. C’est la parole traduite dans le langage corporel. Ce sont des monologues et des dialogues qui usent des mêmes vocables que la peinture, la sculpture et la musique. »
[1] Ce livret a été reproduit intégralement dans le numéro spécial (n° 89) de la Revue Paris Théâtre, en octobre 1954, accompagné de photos dont certaines sont communiquées ci-dessus.
Roland Petit doit donc travailler l’expressivité du langage corporel des danseurs de telle sorte qu’elle ne dépende pas de la musique. C’est une nouveauté pour le jeune chorégraphe dont l’expérience se limite à celle du ballet traditionnel comme, par exemple, « Les Forains » qu’il vient de monter sur la musique d’Henri Sauguet [1].
[1] Pour Les Forains, Roland Petit réglait la chorégraphie au fur et à mesure qu’Henri Sauguet composait la musique destinée aux tableaux successifs.
En outre, concernant la musique, Cocteau a mûri un projet quelque peu original. Il veut appliquer, pour la première fois à la danse, le concept de synchronisme accidentel qu’il a mis précédemment en œuvre au cinéma : les émotions dues aux images ne doivent plus être liées à celles communiquées par la bande sonore. Si coïncidence il y a, elle est simplement fortuite. Autrement dit, la musique ne doit plus s’accorder volontairement au visuel.
C’est ainsi qu’en 1930, pour son court-métrage Le Sang d’un poète, Cocteau avait modifié l’ordre des thèmes musicaux que Georges Auric avait composés en fonction des séquences, désynchronisant ainsi les images et le son. Et pour La Belle et la Bête, son deuxième film et premier long-métrage tourné en 1945, il avait demandé d’emblée à George Auric d’éviter le synchronisme « qui ne doit se produire que par la grâce de Dieu [1]».
[1] Jean Cocteau, La Belle et la Bête, Journal d'un film, Paris, J. B. Janin, 1946. Dernière réédition en date : Monaco, Éditions du Rocher, 2003.
Pour un spectacle de danse comme Le jeune Homme et la Mort, Cocteau tient à ce que les danseurs ne soient pas préparés à la désynchronisation qui doit être spontanée, au moins pour la première représentation. Pour cela les répétitions se dérouleront sur des rythmes de jazz, les danseurs ne devant découvrir que le premier soir l’œuvre de musique classique qui les accompagnera ; Cocteau envisage d’ailleurs l’ouverture de La Flûte enchantée de W. A. Mozart.
En fait, l’œuvre musicale sera la Passacaille et fugue de Jean Sébastien Bach, dans l'orchestration de O. Respighi [1] . Elle n’a pas été choisie par Cocteau, et n’a pas été imposée le soir même, mais elle a été proposée par le chef d'orchestre André Girard [2] deux jours avant la première. Cependant, sa durée habituelle est de l’ordre de 13 à15 minutes, comme mentionné ci-dessus, et le spectacle dure 18 minutes, Qu’à cela ne tienne, le chef ralentira le tempo du morceau pour en allonger la durée !
[1] Selon René Sirvin : https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00702/le-jeune-homme-et-la-mort-de-roland-petit-avec-zizi-jeanmaire-et-rudolf-noureev.html
[2] André Girard (1913 – 1987) a été chef d’orchestre et directeur musical de l’orchestre des Ballets des Champs-Élysées de 1945 à 1950.
Le spectacle sera donné à New York au Metropolitan Opera House en avril 1951. Ensuite il sera repris de nombreuses fois, avec divers danseurs, et présenté à l’étranger avec succès (Berlin, Londres, Milan, Boston, Moscou, Saint-Petersbourg, etc.). Les plus grands danseurs ont inscrit le rôle du Jeune Homme à leur répertoire, en particulier Rudolf Noureev, mais pas à la scène…
Reprise filmée en couleurs pour la télévision avec Rudolf Noureev, 1966
En 1966, trois ans après le décès de Jean Cocteau, Roland Petit devient metteur en scène pour une version filmée de Le jeune Homme et la Mort, diffusée à la télévision le 20 décembre 1966. Les danseurs sont Rudolf Noureev et Zizi Jeanmaire. Roland Petit a adapté la chorégraphie à son nouveau danseur vedette qui, passionné par son rôle, regrettera toujours de ne pas avoir pu reprendre l’œuvre sur scène.
.jpg)
Zizi Jeanmaire en 1963
© Harry Pot, CC BY-SA 3.0 NL, via Wikimedia Commons

Rudolf Noureev et Zizi Jeanmaire
en répétition
(le plateau était entouré de miroirs)
© Jurgen Vollmer


Rudolf Noureev
tel que dans le film
© Jurgen Vollmer
Les trois photos de droite proviennent du site https://noureev.org
Des différences notables existent avec le mimodrame interprété sur scène en 1946. Il s’agit en effet d’un court-métrage et non d’une représentation filmée du ballet avec un nouveau casting. Les interprètes sont traités en acteurs et sont souvent filmés en gros plan, surtout R. Noureev. La mise en scène est simplifiée.
Les costumes ne sont plus ceux de 1946. Le jeune homme ne porte plus la salopette tachée de peinture, il danse torse nu. La jeune femme porte un maillot rouge foncé. La quatrième scène a été supprimée, et le film s’arrête à la pendaison sur un fond de lumière blanche aveuglante.
Quant à la musique, c’est la version pour orgue de la Passacaille jouée sur le grand-orgue de l’église Saint-Séverin à Paris, sans doute par Jacques Marichal (le générique indique « Pierre » Marichal ?).
Sans la quatrième scène, il existe une meilleure adéquation entre les durées respectives de la pièce musicale au bon tempo et du film, ce dernier durant 15 minutes.
Grand-Orgue de l'église Saint-Séverin (Paris)
© Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0,
via Wikimedia Commons
.jpg)
Le film peut être visionné sur la vidéo :
Le Jeune Homme et la Mort à l’Opéra de Paris depuis 1990
Le ballet est entré au répertoire de l’Opéra de Paris le 5 avril 1990, dans sa version initiale chorégraphiée par Roland Petit en 1946 et accompagnée de l’arrangement orchestral de la Passacaille réalisé par O. Respighi. Ce spectacle a donné lieu depuis à onze reprises et quatre-vingt-cinq représentations. Plusieurs danseurs et danseuses différents se sont succédé dans chacun des deux rôles.
La vidéo ci-dessous permet de voir le ballet interprété par Marie-Agnès Gillot et Nicolas Le Riche, version moderne très remarquée. Cette vidéo est due à l’artiste anglais James Dazell et contient en outre son analyse personnelle de l’œuvre. Elle est en anglais, sous-titrée en français.
Cette histoire est celle de la rencontre, à plus de deux cents ans d’écart, survenue dans des conditions tout à fait insolites, de deux œuvres étonnantes, chacune novatrice au moment de leur conception. L’une, écrite et remarquablement construite, est la composition de Jean Sébastien Bach sur un thème poignant ; l’autre, imaginée par Jean Cocteau, est un mimodrame tragique, façonné par l’expression corporelle des danseurs sans support musical définitif, avant même qu’en soit écrit le scénario.
Cette rencontre a donné naissance au « ballet » Le Jeune Homme et la Mort, avant-gardiste et unanimement salué à sa création. Rappelons qu’il n’a pas été chorégraphié sur la musique de Bach comme on le lit ou l’entend couramment : ce n’est pas la réalité. En revanche, soutenu par la musique de la Passacaille de Bach, le Jeune Homme et la Mort révèle toute sa richesse et son individualité.
Depuis quatre-vingts ans, ce « ballet » n’a cessé d’être représenté en France comme à l’étranger [1], continuant d’émouvoir le public confronté au destin tragique que le jeune homme porte en lui, destin inexorable dont l’ostinato de la Passacaille de Jean Sébastien Bach en est perçu comme étant l’expression.
[1] Il existe même une nouvelle version filmée. Elle est incluse dans l’ouverture du film américain de Taylor Hackford White Nights (Soleil de Nuit), sorti aux États-Unis en novembre 1985 et en France en janvier 1986. Roland Petit a réglé l’interprétation de Le jeune Homme et la Mort par Mikhaïl Baryshnikov et Florence Faure. La musique est un arrangement de la Passacaille de Bach par Michel Colombier, qui a obtenu le Golden Globe de la meilleure musique de film en 1986.
CODA
Sources :
• Alberto Basso, Jean Sébastien Bach, Paris, Fayard, 2 vols. 1984, 1985
• Marie-Claire Alain, Livret de l'intégrale de l'Œuvre pour orgue de J. S. Bach, Erato, 1980, pp. 86-88
• Gilles Cantagrel, dans Guide de la Musique d'Orgue, Paris, Fayard, 1991, pp. 63-66
• Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, The learned musician, Oxford University Press, 2014
• France Musique. Le jeune homme et la Mort. 19 septembre 2025
• France Musique. Pourquoi Le Jeune Homme et la Mort de Roland Petit est un chef d’œuvre. 9 juillet 2018.
• France Culture. Le ballet Le jeune homme et la Mort raconté par Jean Cocteau.14 janvier et 29 décembre 2024
• CND Médiathèque Le jeune homme et la Mort
Notice de Camille Riquier Wautier
• Jean Cocteau, unique et multiple
https://cocteau.scdi-montpellier.fr
• Pour la signature de Jean Sébastien Bach, sous le titre, le crédit est : © Morn, Public domain, via Wikimedia Commons
QUE D'ORGUES ! QUE D'ORGUES !
LA DÉMESURE DU BARON DE L'ESPÉE ET L'ORGUE DU SACRÉ-CŒUR
UN BARON SINGULIER : ALBERT DE L'ESPÉE (1852 - 1918)
Décrit comme un personnage misanthrope aux comportements déroutants, le baron Albert de l’Espée a quelque chose d’insaisissable. Ne serait-ce qu’à cause de ses voyages incessants de l’une à l’autre de ses dix propriétés dispersées en France, se dérobant à la compagnie de sa femme Delphine de Bongars (épousée en 1883) et de son fils René (né en 1890), de sa propre famille et du monde dont il cherche avant tout à s’isoler. Il semble leur préférer ses domestiques, qui l’accompagnent, et ses chiens de chasse, qu’il vénère.
Albert de l’Espée descend par sa mère de la riche dynastie des Wendel, maîtres de forge à Hayange, en Lorraine [1]. Ses rentes, comme ses placements financiers, lui permettent de vivre largement et de dépenser sans compter pour satisfaire ses passions : la chasse et l’orgue, ainsi que ses lubies, liées à sa santé délicate.
[1] Orphelin de père peu avant l’âge de trois ans, Albert de l’Espée a vécu en Lorraine, et principalement à Metz, avec sa mère, son frère et sa sœur pendant son enfance et son adolescence.

Les forges d'Hayange en 1866
Charles de Bertier
© Musée d'Orsay
Dès l’âge de 27 ans, il commence à faire construire ou à aménager à grands frais diverses propriétés dont il choisit la localisation de façon à conjuguer salubrité du climat, alentours giboyeux, beauté et isolement des sites. Ce seront ainsi huit domaines qu’il bâtira selon ses fantaisies. Le baron transforme également le château des Bongars à Kéroset, près de Vannes, qu’il rachète à sa femme en 1891, et conserve le château d’Antibes, hérité de sa mère en 1892. Toujours à la pointe des nouveautés techniques, il équipe ses domiciles des perfectionnements les plus récents (captation et distribution de l’eau, chauffage, électricité …).
Cette quête des techniques les plus avancées répond à l’exigence d’un environnement le plus sain possible, de l’asepsie la plus poussée, afin d’éviter tout risque d’une contamination car le baron de l’Espée, qui n’a pas totalement guéri d’une bronchite chronique contractée dans son enfance, a peur des germes. Il connaît la responsabilité des microorganismes dans le développement des maladies, mais sait qu’aucun traitement efficace n’est possible. Obsédé par la nécessité de s’abriter des microbes, il développe quantité de manies et de rituels qu’il impose à ceux qui le servent, pour maintenir une hygiène draconienne. Son comportement hypochondriaque le fait qualifier d’original, de fantasque, d’excentrique, d’extravagant, selon les textes le concernant qui regorgent d’anecdotes sur sa façon de vivre.
LA PASSION DE LA MUSIQUE ET, PAR-DESSUS TOUT, DE L'ORGUE

Richard Wagner, Paris, 1861
Photographie prise lors de son séjour à Paris pour la première de Tannhauser
© Pierre Petit, Public domain, via Wikimedia Commons
Une autre quête caractérise le baron de l’Espée, celle de posséder pour lui seul des orgues permettant, par leur puissance et la variété de leurs jeux, de jouer des réductions d’œuvres orchestrales, tout particulièrement celles d’opéras de Wagner dont il est passionné.
Le goût de la musique l’habite depuis l’enfance quand il a appris à jouer du piano. Cependant, c’est l’orgue qui va le subjuguer. À l’âge de huit ans, alors qu’il séjourne chez son grand-père à Froville au sud de Nancy, il entend le curé jouer de l’harmonium dans l’église du prieuré roman où le son et la résonance de l’instrument le fascinent. À Metz, où il habite, il peut également écouter l’orgue de l’église Notre-Dame et, peut-être même, celui de la cathédrale Saint-Étienne.
On devine que son enthousiasme pour l’instrument le conduira à essayer de petits orgues lorsque l’occasion se présentera. Jusqu’au moment où survient une expérience décisive : en 1865, le marquis Ernest de Lambertye, qui a fait installer par A. Cavaillé-Coll un superbe orgue de trois claviers et 37 jeux dans la chapelle de son château à Gerbéviller (voir encadré ci-dessous), inaugure l’instrument par un concert auquel Albert est invité. Le marquis invite le jeune adolescent à monter à la tribune et à s’asseoir à côté de lui. À la fin du concert, Albert a le droit d’essayer l’orgue et malgré son inexpérience, il est applaudi. Voilà sa passion résolument déclarée, elle ne le quittera plus.
L'orgue Cavaillé-Coll du marquis de Lambertye à Gerbéviller
Le marquis Ernest de Lambertye, propriétaire du château de Gerbéviller, a décidé en 1860 de restaurer la chapelle de l'ancien couvent des Carmes déchaussés située à côté du château. Elle fut alors somptueusement décorée et dotée de l'orgue Cavaillé-Coll mentionné ci-dessus et inauguré en 1865.
Après le décès du marquis, en1909, son neveu et héritier a vendu l'orgue à l’église Saint-Maurice de Bécon-les-Bruyères de Courbevoie où il a été installé par Charles Mutin.
Ce fut une chance car une grande partie du château et la chapelle ont été ravagées peu après par un incendie déclenché par les troupes bavaroises, au début de la guerre, en août 1914.
.jpg)
L'orgue de l'église St-Maurice de Bécon-les-Bruyères.
La partie centrale est l’œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll, elle porte l'anagramme d'Ernest de Lambertye ; les deux buffets latéraux ont été réalisés et posés par Charles Mutin lors de l'installation de l'orgue dans l'église.
© Inventaire des orgues
.jpg)
Le château et le parc de Gerbéviller
© collection O. Geoffroy/www.musimem.com

Chapelle du château de Gerbéviller
Les parties hautes des clochers détruites pendant la guerre n'ont pas été reconstruites
© Paul Queste, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
En 1867, Albert se rend à Paris avec sa mère pour visiter l’Exposition universelle. Il y rencontre un de ses cousins, Marcien de l’Espée, dont l’épouse tient un salon fréquenté par le monde musical. L’adolescent fait connaissance, en particulier, du compositeur messin Ambroise Thomas. Le domicile de Marcien est proche de l’église Sainte-Clotilde dont l’orgue Cavaillé-Coll est tenu par César Franck. Il est possible qu’Albert l’ait entendu. Toujours est-il que c’est à ce moment que le jeune homme âgé de quinze ans, fasciné par la puissance de l’instrument, décide de posséder un jour un orgue d’une envergure inégalée pour un particulier. Pense-t-il déjà que la réalisation de son désir ira jusqu’à faire bâtir sa résidence autour de l’orgue et non à choisir un orgue s’intégrant dans les lieux ?
_jp.jpg)
César Franck à l'orgue
de Sainte-Clotilde en 1888
Photo du tableau de Jeanne Rongier
© Painting: Jeanne Rongier (1852-1934) ; Photo: Braun & Co, Public domain, via Wikimedia Commons
Après sa majorité, vers 1875, Albert de l’Espée effectue de fréquents séjours à Paris. C’est l’occasion de découvrir de nombreux opéras-comiques, comme « La fille de Madame Angot » de Lecocq, « La jolie parfumeuse » d’Offenbach, etc. qui font alors fureur. C’est aussi l’opportunité de fréquenter l’atelier de facture d’orgues d’Aristide Cavaillé-Coll avenue du Maine, d’écouter comme d’essayer des orgues chez le constructeur ou dans des églises. En comparant divers instruments, dont son intelligence et ses connaissances lui permettent d’appréhender les aspects techniques, il peut se formuler plus précisément l’orgue auquel il aspire.

Livret de "La fille de Madame Angot"
Opéra-comique en 3 actes de Charles Lecocq, créé le 21-02-1873 à Paris, aux Folies Dramatiques
© Scan by NYPL, Public domain, via Wikimedia Commons

Manufacture Cavaillé-Coll av. du Maine à Paris, gravure
© Loïc Métrope

Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899)
vers 1865
© Adolphe Dallemagne, Public domain, via Wikimedia Commons

Audition d'un grand-orgue dans la manufacture d'orgues de M. Cavaillé-Coll le 12 mars 1870
Il s'agit du second orgue de John Hopwood avant son transfert dans le cottage de Bracewell (Yorkshire), puis au Ketton Hall et enfin à Warrington où il se trouve actuellement.
L'Illustration, janvier-juin 1870, numéro 1411, page 196
© Bayerische Staatsbibliothek, Public domain, via Wikimedia Commons
Mais en 1878, les forges d’Hayange, qui ont pris du retard pour produire de l’acier plutôt que de la fonte, rencontrent de sérieuses difficultés. Les finances d’Albert ne l’autorisent pas encore à acheter l’orgue de ses rêves.
À partir de 1879, sa santé le contraint à séjourner fréquemment à Antibes dont le climat lui est favorable. L’entreprise d’Hayange retrouve sa prospérité grâce à l’achat d’un brevet de fabrication de l’acier. Albert va pouvoir profiter des retombées financières. C’est alors qu’il achète un terrain aux Adrets de l’Estérel et y fait construire la première de ses villas, déjà novatrice tant au plan architectural que pour ses aménagements techniques. En outre, en 1880, il commande le premier de ses orgues à A. Cavaillé-Coll pour le château d’Antibes, qui appartient alors à sa mère. L’instrument doit s’adapter à l’emplacement prévu dans le salon, et Albert doit se contenter d’un orgue à deux claviers et dix jeux.

Château de l'Espée à Antibes
© Abxbay, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
CONSTRUIRE, CHASSER, SE GRISER DU SON D'UN ORGUE
C’est à partir de 1879 qu’Albert de l’Espée commence à mener l’existence atypique déjà évoquée, si différente de celle qu’on attendrait d’un aristocrate fortuné comme lui. Les éléments dont on dispose traduisent l’instabilité d’un hypochondriaque, au demeurant bâtisseur insatiable et novateur, chasseur invétéré, et musicien confirmé en quête d’exaltation aux claviers de ses orgues.
Quelles sont les diverses propriétés qui ont abrité les excentricités du baron de l’Espée, et quelles sont celles qui ont été dotées d’un orgue ? En consultant les trois encadrés ci-dessous, on peut se faire une idée de huit de ces résidences dont six ont été enrichies par la présence d’un orgue, ou d’un instrument apparenté. Les deux propriétés non recensées dans les encadrés sont le château de Kéroset, déjà cité, et le château d’Ilbarritz. Kéroset était un bien de la famille Bongars que le baron a, certes, racheté mais qui n’a pas de réel rapport avec notre propos. En revanche, le château d’Ilbarritz, lieu-dit situé au pays basque entre Biarritz et Bidart, va mériter toute notre attention dans la section suivante, compte tenu des deux orgues extraordinaires qu’il a hébergés.

Vue d’ensemble de huit propriétés (parmi les dix) d’Albert de l’Espée, avec leur localisation.
Quelques explications sont données sur les résidences elles-mêmes (en noir) et sur les orgues ou instruments apparentés qu’elles ont hébergés (en rouge).

Château de Taillefer
à Belle-Île, vers 1900
© Christophe Luraschi


Quant à la solitude affective dans laquelle Albert de l’Espée semble s’être réfugié, elle a été ponctuée d’aventures éphémères. Seule une période de huit années, de 1890 à 1898, où il entretient sa maîtresse Biana Duhamel, a peut-être apporté une couleur différente au cours de son existence, en particulier lors du séjour à Ilbarritz, comme nous le verrons.
Étant retourné dans le midi à la fin de sa vie, il correspond régulièrement avec son fils et noue une liaison avec sa gouvernante. Alors que cette dernière s’est absentée quelques jours, Albert de l’Espée décède quasiment seul le 4 janvier 1918, à l’âge de 65 ans, dans une petite pension de Juan les Pins. Dix-huit mois plus tôt, son divorce a été prononcé à ses torts. En 1920, son corps est transféré dans la chapelle sépulcrale de la famille à Hayange. Certains de ses orgues disparaissent, d’autres sont réutilisés, en totalité ou en partie, dans des églises. C’est notamment le cas du premier des orgues d’Ilbarritz dont la partie instrumentale est maintenant celle de l’orgue de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, mais n’anticipons pas …
ILBARRITZ ET SES ORGUES MONUMENTAUX
Fin 1889, un voyage d’agrément effectué par Albert de l’Espée et son épouse à Biarritz le convainc d’établir là une nouvelle propriété. Le climat océanique de cette station thermale et balnéaire n’est-il pas bénéfique pour ceux qui souffrent de maladies respiratoires ?
L’année suivante est décisive. Le baron, tombé amoureux de l’actrice Biana Duhamel qui triomphe au théâtre des Bouffes Parisiens dans l’opérette d’Edmond Audran « Miss Helyett », la rencontre secrètement et rêve d’une résidence isolée pour disposer de sa présence selon son bon vouloir. Pourquoi ne serait-ce pas dans la propriété espérée sur la côte basque ?

Mlle Biana Duhamel (1870-1910)
Atelier Nadar, 1892
© BNF, Public domain, via Wikimedia Commons

A. Cavaillé-Coll à son bureau
L’Illustration n°2672, 12 mai 1894
© Loïc Métrope
Aspirant à doter cette future propriété d’un orgue symphonique, et curieux de connaître le magnifique instrument que Cavaillé-Coll a construit en 1873 pour la grande salle de concert « Albert Hall » de Sheffield [1], Albert de l’Espée se rend sur place pour l’essayer. Une particularité de cet orgue est d’avoir été conçu pour évoquer l’orchestre symphonique, avec les cuivres surélevés à l’arrière. Cette disposition n’est sans doute pas étrangère au coup de cœur ressenti par le baron qui commande aussitôt au facteur d’orgues un orgue sur le même modèle, tant pour le buffet que pour la partie expérimentale.
[1] Ville d’Angleterre, située à environ 60 km à l’est de Manchester.

Salle de concert Albert Hall de Sheffield
avec l'orgue Cavaillé-Coll en 1873
Cette salle de concert pouvait accueillir 3000 auditeurs et 300 exécutants.
L'orgue a été détruit dans l'incendie de la salle le 14 juillet 1937
Albert de l’Espée retourne à Biarritz et engage l’architecte réputé Gustave Huguenin avant même d’avoir trouvé un terrain à acquérir. Ce dernier reçoit pour mission d’édifier une maison qui puisse héberger l’orgue tant désiré. En 1893, le baron se voit enfin proposer un terrain à acheter qui lui convient. C’est un domaine de 60 ha, situé au lieu-dit « Ilbarritz », obtenu par la réunion de 75 parcelles appartenant à une trentaine de propriétaires. Il s’étend du haut de la colline de Handia à la plage, avec 1500 m de littoral. Pour établir les plans de la maison, à laquelle s’ajoutent une quinzaine de bâtiments annexes et trente-cinq autres petites constructions, l’architecte dessinera mille deux cents plans !
Les travaux débutent en 1894 et sont gigantesques. Les moyens financiers engagés s’avèrent faramineux. La maison comporte cinq étages dont deux réservés à l’orgue dont la construction commence à Paris ; cet instrument résidera dans une immense salle dont l’acoustique a été optimisée par des acousticiens (voir le plan ci-dessous). La décoration et les matériaux sont du plus grand luxe. Cette salle est achevée en 1897, comme le reste du château.

Le château d'Ilbarritz
Pyrénées magazine Mars 1914
© gallica.bnf.fr/BNF
La salle de l'orgue dans le château d'Ilbarritz
Photo récente, montrant le mur côté est contre lequel se trouvait l'orgue.
La galerie est représentée par des pointillés sur le plan.

© forbidden places, Sylvain Margaine
https://www.forbidden-places.net/exploration-urbaine-Le-Chateau-d-Ilbarritz#19

Plan du 1er étage du château d'Ilbarritz montrant l'importance de la salle d'orgue
L'escalier est en bois et non en pierre pour des raisons d'acoustique
Les dépendances sont, elles, terminées en 1898, mais dès 1896, la « Villa des Sables » construite en limite extérieure de la propriété, est offerte à Biana Duhamel qui ne pénétrera dans le domaine que lors de ses rendez-vous avec le propriétaire. Quant aux chiens, ils ne sont pas oubliés : en plus d’un chenil réservé à ceux qui sont bien portants, le baron prévoit, pour ceux qui sont malades, un pavillon dont l’aménagement luxueux comporte eau courante et chauffage. Mentionnons encore quatre kilomètres de chemins ouverts ou couverts, interrompus de petits bungalows aménagés, chauffés, etc., qui relient les dépendances entre elles. De nombreuses descriptions des lieux et de leurs extravagances ont été publiées. Elles ont contribué à faire d’Ilbarritz un lieu légendaire.

Le domaine d'Ilbarritz
au début du XXe siècle
Noter les allées couvertes
Qu’en est-il de l’orgue commandé à A. Cavaillé-Coll en 1890 ?
L’orgue est livré progressivement dès que l’état de la salle d’orgue le permet. En mars 1898, il reste encore 14 jeux d’anches à monter, et l’harmonie générale à réaliser [1]. Selon D. Roth, l’orgue pourrait avoir été achevé fin novembre 1898. Notons que cet orgue est alors le quatrième de France et le troisième plus grand qu’a construit le célèbre facteur d’orgues. Étant donné qu’Aristide Cavaillé-Coll, dont la santé déclinait, avait cédé la gestion de son entreprise à Charles Mutin le 15 mars 1898, l’achèvement de l’orgue revint à la maison « Cavaillé-Coll-Mutin ».
[1] Cela est stipulé sur le devis établi au moment de la cession de la maison Cavaillé-Coll à Charles Mutin, comme le mentionne D. Roth

Charles Mutin
Le Monde Musical, VI/18 30 janvier 1895
Une question se pose : jusqu’à quel point A. Cavaillé-Coll a-t-il reproduit, à Ilbarritz, l’orgue de Sheffield ? En ce qui concerne les buffets, ils sont pratiquement identiques, comme le montre la figure ci-dessous. C’est aussi le cas des claviers manuels et des transmissions. Pour ce qui est des compositions, les différences ont été analysées en détail par Daniel Roth : elles portent sur le nombre et la nature des jeux qui ont été adaptés à la localisation et à la vocation de chaque instrument. Environ la moitié des jeux est spécifique à chacun des orgues. En outre, avec 18 jeux au pédalier à Ilbarritz, soit six de plus qu’à Sheffield, ce clavier de pédale devient le plus important de France.

Il existe également une différence entre les consoles. Alors que celle de l’orgue de Sheffield est de facture courante, la console d’Ilbarritz est en amphithéâtre, telle celles des orgues de Saint-Sulpice et de Notre-Dame à Paris [1]. Dans la grande salle d’orgue, cette superbe console orientée face à l’océan devait contribuer à l’extase ressentie par le baron qui, dit-on, jouait du Wagner, fenêtres ouvertes, au gré de son humeur de jour ou de nuit.
Dernière remarque : alors que six souffleurs sont préconisés à Sheffield pour fournir le vent, l’orgue d’Ilbarritz bénéficie d’une soufflerie électrique située au rez-de-chaussée de la maison sous l’instrument. Trois ventilateurs actionnés par des dynamos emplissent trois grands soufflets [2].
[1] Aristide Cavaillé-Coll ne construisit que trois exemplaires de cette console en amphithéâtre.
[2] Au sous-sol des accumulateurs sont rechargés par une véritable centrale hydroélectrique qui alimente l’ensemble de la propriété, en particulier pour l’éclairage, la climatisation et le chauffage de l’eau des piscines.
L’orgue monumental installé en 1898 ne restera pas très longtemps à Ilbarritz car le baron le revend à C. Mutin en 1903, qui le démonte et le transporte dans les locaux Cavaillé-Coll-Mutin de l’avenue du Maine. En 1905, il est remonté et présenté en démonstration jusqu’en 1913 [1], date à laquelle il est acheté par la basilique du Sacré-Cœur à Paris (cf. ci-dessous).
[1] Charles Mutin a sans doute cherché à vendre l’orgue à différents endroits. Un courrier à l’organiste et maître de chapelle de Burgos prouve que Mutin avait proposé cet orgue pour la cathédrale de cette ville.
L'orgue Cavaillé-Coll de 1898
dans la salle de montage de l'avenue du Maine à Paris en 1909

Pourquoi Albert de l’Espée s’est-il séparé de cet orgue tant désiré ? Deux raisons différentes sont invoquées, mais qui ne s’avèrent pas exclusives l’une de l’autre. Pour certains, l’orgue, trop important pour la pièce et trop sonore, n’a pas donné la satisfaction espérée et son propriétaire a décidé de s’en départir. Pour son biographe, C .Luraschi, le départ de l’orgue était nécessaire pour pouvoir vendre le domaine d’Ilbarritz, résolution qu’aurait prise le baron à la suite de sa rupture avec Biana Duhamel qui avait quitté les lieux. Cet évènement conduit en tout cas le baron de l’Espée à déserter quelque temps le domaine d’Ilbarritz.
Une nouvelle maîtresse, un nouvel orgue qui défie l’imagination
Début 1905, Albert de l’Espée, qui a apprécié le climat hivernal d’Ilbarritz où il vient de séjourner, renonce à vendre son domaine et entreprend de nouveaux travaux. À cette occasion il fait édifier un bâtiment adossé au château dans lequel une vaste chambre avec vue sur l’océan est prévue pour sa nouvelle maîtresse, une jolie blonde originaire d’Autriche.
C’est l’occasion de commander à C. Mutin un autre orgue véritablement « orchestral », un peu plus petit que le précédent, mais quelque peu insolite car il doit restituer au mieux l’orchestre de Wagner. Pour le réaliser C. Mutin va innover avec beaucoup d’intérêt, tant technique que financier. L’orgue sera installé dans la grande salle de l’orgue en 1907.
Ses caractéristiques sont résumées sur la figure ci-dessous qui lui est consacrée. L’étendue des claviers (du la0 au do6) et du pédalier (du la0 au sol3) est inhabituelle. Pour faire sonner certains jeux comme les tubas wagnériens, C. Mutin emploie une technique ancienne pour obtenir les notes graves. Afin d’étendre les possibilités sonores de l’orgue, il lui faut inventer de nouveaux jeux, comme "le Cor d’harmonie", jeu à anches battantes, destiné à reproduire le son du cor bouché de Siegfried avec son attaque particulière, ou "la Musette" qui est une sorte de basson [1]. C. Mutin ajoute aussi cinq combinaisons ajustables, telles qu’elles avaient été imaginées par Paul Veerkamp (1849 – 1923), l’harmoniste de Cavaillé-Coll.
[1] Ces jeux semblent avoir été reconduits pour l’orgue de 1912 à Monte-Carlo.


En 1910, la maîtresse autrichienne est remerciée, et le baron remet son château en vente, avec l’orgue. La vente est conclue en décembre 1911 avec la Société immobilière de la Côte basque administrée par Pierre-Barthélémy Gheusi, journaliste, écrivain et futur directeur de l’Opéra-Comique. Ce dernier ouvre la propriété au public le 10 avril 1912, à l’occasion d’une fête en faveur de l’Aviation Militaire Française, avec un concert dans la salle d’orgue, où l’organiste est Joseph Daëne, musicien réputé à Bordeaux. Par la suite, le château ayant été transformé en hôpital militaire en 1914, des concerts d’orgue ont été organisés pour divertir les blessés.
Pierre-Barthélemy Gheusi photo parue en 1917 dans la revue "Le Théâtre et la musique"
Au cours des années suivantes, le domaine d’Ilbarritz connaît diverses péripéties. L’orgue est pillé et son histoire devient confuse. On sait qu’il a été racheté par un médecin de Biarritz, le Dr Bastide qui, en 1920, en revend une partie à la paroisse d’El Salvador à Usúrbil près de Bilbao ; il s’agit précisément de : 22 jeux, le buffet, une grande partie des soufflets, la console, les jeux de Grand-Orgue et de Positif, leurs mécanismes pneumatiques et leurs transmissions, ainsi que les jeux d'anches en chamade. Le médecin conserve les autres éléments pour en faire l’orgue de sa salle de musique. En 1956, ce dernier devient l’orgue du monastère Sainte-Scholastique d’Urt dans les Pyrénées-Atlantiques. Quelques jeux, mais très peu, ont été conservés pour le nouvel orgue construit en 1995 par le facteur Robert Chauvin de Dax pour ce monastère. Quant à l’orgue d’Usúrbil, ultérieurement restauré, complété, réharmonisé, il est considéré aujourd’hui comme le plus grand orgue symphonique d’Espagne.
L'ORGUE DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE
Lorsque C. Mutin réintègre le premier des orgues d’lbarritz dans ses ateliers parisiens, il entreprend quelques modifications dans la composition. Il ajoute quatre jeux : deux au grand-orgue, un au positif, un au récit, portant le nombre total de jeux à 74. Par ailleurs onze des jeux de cet orgue de 1898 sont remplacés par des jeux différents. Ce faisant, C. Mutin rééquilibre l’orgue qui était pauvre en mutations et en mixtures par rapport aux jeux de fond et d’anches de 16’ et 8’. En 1906, l’orgue ainsi transformé possède 5384 tuyaux.
Dorénavant C. Mutin dispose, en démonstration, d’un magnifique instrument, comme en témoigne Albert Schweitzer qui, après avoir essayé l’orgue dans les locaux de l’avenue du Maine, écrit en 1906 : « Je n’hésite pas à déclarer que cet orgue de l’atelier de Mutin, dont le constructeur ne veut pas se séparer, est techniquement et artistiquement le plus parfait qui ait peut-être jamais été construit. »

Le Dr Albert Schweitzer à l'orgue
de la salle Poirel de Nancy en 1952
© Photos Hugy, CC0, via Wikimedia Commons
En 1913, l’occasion de vendre l’ancien orgue du baron dans de bonnes conditions se présente lorsque l’orgue provisoire dont disposait la basilique du Sacré-Cœur à Paris (un petit Cavaillé-Coll de 17 jeux, trop réduit) est transféré à l’Église Notre-Dame du Rosaire. Le Comité du Vœu National engage alors des pourparlers avec C. Mutin en vue de racheter l’orgue d’Ilbarritz, ce qui a lieu en fin d’année. L’architecte de la basilique, Lucien Magne [1], est sollicité pour construire un nouveau buffet, le style Renaissance du précédent ne s’accordant pas avec le bâtiment [2]. Des travaux sont également nécessaires pour transformer la tribune destinée à accueillir l’instrument.
[1] Lucien Magne meurt en juillet 1916. Jean Hulot, son successeur, restera architecte de la Basilique jusqu’à son décès en 1959.
[2] Daniel Roth rapporte qu’Auguste Convers, le successeur de Charles Mutin, utilisa le buffet de l’orgue d’Ilbarritz pour un instrument de 50 jeux qui fut acheté par la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux. Au montage, la boiserie servit à réaliser les soubassements nécessaires au montage de l’orgue (!).
En 1914, C. Mutin commence à monter l’orgue. Cependant, en août, la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France perturbe et ralentit le déroulement des divers travaux. Peu d’informations sont disponibles sur la période 1914 - 1919. On sait néanmoins que le sculpteur Buisine de Lille, chargé de l’exécution du buffet, ayant terminé sa tâche au moment de la déclaration, a entreposé les éléments de la boiserie dans 37 caisses stockées dans le hall de son entreprise. Le déménagement n’a pas pu avoir lieu à temps et l’usine a été entièrement détruite par les bombardements. Tout aurait dû être à refaire … sauf que, par miracle, les caisses, pourtant inflammables, ont été retrouvées intactes dans les décombres !
_edited.jpg)
Le journal "Le Matin" du 3 août 1914
L’inauguration du grand-orgue enfin installé se déroule lors de la consécration de la basilique, le 16 octobre 1919. Ch.-M. Widor exécute l’Andante de sa Symphonie gothique, M. Dupré interprète le Salvum fac populum tuum de Widor et l’organiste titulaire, Abel Decaux, joue diverses pièces pour orgue, de César Franck, Ch.-M. Widor, L. Vierne, etc. L’orgue reçoit beaucoup d’éloges, bien que l’acoustique, discutable en raison de l’immense coupole de 55 m de hauteur, soit déplorée.
Cet orgue, qui possède aujourd’hui 78 jeux, est considéré comme l’un des instruments les plus remarquables de France. Sa partie instrumentale a été classée au titre des monuments historiques en janvier 1981.

Partition de la Symphonie Gothique
de Charles-Marie Widor, composée en 1895
édns Schott, Public domain, via Wikimedia Commons
.jpg)
La console du grand-orgue du Sacré-Cœur
Les porcelaines des tirants de registres sont cerclées d'une couleur différente selon le plan sonore : bleu pour le GO, jaune pour le Positif, Rouge pour le Récit, vert pour le Solo, marron pour la Pédale (code couleur habituel de C. Mutin).
© Marius Beckmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Le grand-orgue de la Basilique du Sacré-Cœur
Photo : Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
© Sophie Lloyd
De nombreux organistes réputés ont joué sur cet orgue, en particulier des organistes titulaires. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, il faut citer Rolande Falcinelli (1920 – 2006), titulaire de 1946 à 1973, et Daniel Roth, son suppléant à partir de 1963, puis titulaire de 1973 à 1985, année où il fut nommé à Saint-Sulpice. Actuellement, les organistes titulaires sont Gabriel Marghieri et Philippe Brandeis, depuis 1994, ainsi que Luc Stellakis, depuis 2013.
.jpg)
Rolande Falcinelli en1980
© Blanchitout, CC BY-SA 4.0
via Wikimedia Commons

Daniel Roth
Préparation d'un concert "Hommage à Albert Schweitzer", à Wihr-au-Val 23-09-2025
© Wernain Samuel, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Comme tout orgue, celui-ci a connu des turbulences. La première restauration a lieu en 1930-31 par la manufacture Pleyel-Cavaillé-Coll. S’en est suivi, en 1948, un relevage par Jean Perroux, ancien harmoniste de la maison Cavaillé-Coll. En 1959-60, une deuxième restauration est effectuée par la maison Beuchet-Depierre de Nantes, sous la direction de Rolande Falcinelli et de Marcel Dupré. La partie centrale du buffet est alors supprimée pour dégager la verrière, et la tuyauterie réorganisée. De 1970 à 1976, l’orgue se dégrade considérablement en particulier à cause de l’installation d’un chauffage à air pulsé (fissures, empoussiérage, …). L’instrument subit des pannes répétées. Après des réparations d’urgence en 1979, une restauration est réalisée de 1980 à 1985 par Jean Renaud, à l’initiative de Daniel Roth, alors titulaire. En 2013, la maison Muhleisen restaure la soufflerie, située au-dessus de la voûte, dans les combles de la basilique.
En 2024, l’orgue est à nouveau en très mauvais état. C’est pourquoi il bénéficie, depuis mars 2025, d’une nouvelle grande campagne restauration dont la durée est estimée à deux ans (démontage, relevage, nettoyage et remise en jeu), sous la houlette de la manufacture Robert Frères, SARL Michel Jurine.
Dernier grand instrument d’A. Cavaillé-Coll (environ 70 % des tuyaux sont encore d’origine), le grand-orgue du Sacré-Cœur est assurément un des trésors du patrimoine organistique français.
Or, c’est aux goûts démesurés de l’organiste amateur et passionné que fut le baron Albert de l’Espée que nous le devons. Avait-il imaginé, qu’en quittant la colline d’Ilbarritz, son orgue connaîtrait une destinée admirable, cette fois sur la butte de Montmartre, suscitant l’enthousiasme immodéré d’Olivier Messiaen ?
« Je considère l’orgue du Sacré-Cœur
comme l’un des plus beaux de Paris, de France et du Monde »
Cité par Daniel Roth, cf. Sources.

© Giò Terra (Terragio67), CC BY-SA 4.0,
via Wikimedia Commons
Sources :
Ouvrages et articles de revues
• Christophe Luraschi, Albert de l’Espée (1852 – 1918), Atlantica, Biarritz, 1999.
• Carolyn Shuster-Fournier, Les orgues de salon d’Aristide Cavaillé-Coll, L’orgue, Cahiers et Mémoires, 1997.
• Daniel Roth, Le Grand Orgue du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, La Flûte Harmonique, n°s 33/35, 1985.
• Montaudran, Le château d’Ilbarritz, La Nouvelle Revue, mai-juin 1912, pp. 540-550 (gallica.bnf.fr/BNF).
• Le grand orgue de la nouvelle salle de concert de Sheffield en Angleterre, construit par Aristide Cavaillé-Coll à Paris, Plon, Paris, 1874 (gallica.bnf.fr/BNF).
• Pierre Sicard, Les orgues du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, Omni-presse, Lyon, 1964.
• Cécile et Emmanuel Cavaillé-Coll, Aristide Cavaillé-Coll, Ses origines. Sa vie. Ses œuvres, Librairie Fischbacher, Paris, 1929 (gallica.bnf.fr/BNF).
• Loïc Métrope, La Manufacture d’orgues Cavaillé-Coll avenue du Maine, Aux amateurs de livres, Paris, 1988.
• Antoine Thomas, Technique et esthétique des orgues de la manufacture Cavaillé-Coll-Convers, Mémoire de recherche (Master), CNSMDL, 2022.
• Chantal Brérot et Jacques Bachellerie, Un air de pays basque à Montmartre, Montmartre en Revue, juin 2024 pp. 38-40 et oct. 2024, pp. 66-68.
Sites internet :
• Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, https://www.sacre-coeur-montmartre.com/decouvrir/patrimoine-et-art-sacre/le-grand-orgue/
• Inventaire des Orgues, Basilique du Sacré-Cœur, https://inventaire-des-orgues.fr/detail/orgue-paris-basilique-du-sacre-cur-fr-75056-paris-scoeur1-t/
• Patrimoine et inventaire de Nouvelle aquitaine, Château et parc d’Ilbarritz, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/cbf57b9c-fcbc-4a49-b8e5-ff7c656b495f/chateau-et-parc-d-ilbarritz?_lg=fr-FR
• Musica et Memoria, Organistes du Sacré-Cœur de Montmartre, http://www.musimem.com/sacre-coeur.htm
• Association Aristide Cavaillé-Coll, Chronologie des œuvres d’ACC, https://www.cavaille-coll.fr/chronologie/
• Les Orgues de Charles Mutin, https://orguesmutin.fr
• Forumopera.com, Christophe Rizoud, Albert de l’Espée, la folie de la pierre, https://www.forumopera.com/albert-de-lespee-la-folie-de-pierre/
• Blog : Memorias de un organista de provincias (en espagnol) https://villaumbrosa.wordpress.com/2010/09/16/de-como-un-organo-de-salon-del-baron-de-lespee-se-convirtio-en-el-organo-sinfonico-mayor-de-espana/
L’ORGUE DE LA GROTTE DE TÉTHYS ET LES CHANTS D'OISEAUX
À l’emplacement du vestibule de l’actuelle Chapelle Royale du Château de Versailles [1] fut édifiée de 1665 à 1668 une étonnante grotte artificielle, animée de jeux d’eau et de lumière, emplie de musique et de chants d’oiseaux, telle que la voulut Louis XIV. Cette grotte possédait un orgue qui est aujourd’hui l'objet de toute notre attention.
[1] Inaugurée en 1710, après 23 ans de travaux.
UNE GROTTE ENCHANTÉE
Imaginée par Charles Perrault [1] à la manière des grottes italiennes de la Renaissance, et dessinée par son frère, l’architecte Claude Perrault, cette grotte féérique fut consacrée à Téthys, sœur et épouse d’Océan. Ch. Perrault voulut que la grotte soit ouverte vers l’ouest, de sorte que le soleil couchant l’illuminant le soir soit la métaphore de la venue du Roi-Soleil y cherchant le repos à la tombée du jour [2] … Charles Le Brun y aménagea un savant jeu de miroirs et les fontainiers François Francine et Denis Jolly, lequel avait travaillé pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte, construisirent les jeux d’eau et les divers mécanismes hydrauliques.
[1] Charles Perrault (1628-1703), avant de devenir le conteur célèbre, était protégé de Colbert et fut chargé en 1663 par ce dernier de la politique artistique et littéraire du roi en tant que Secrétaire de la Petite Académie.
[2] Charles Perrault a écrit dans ses mémoires : « Je songeai [qu’]il serait bon de mettre Apollon [le Soleil] qui va se coucher chez Thétis, après avoir fait le tour de la Terre, pour représenter que le Roi vient se reposer à Versailles après avoir travaillé à faire le bien de tout le monde ». Quant à Jean de la Fontaine, il est encore plus précis dans son poème « Les amours de Psyché et de Cupidon » (1669) : « Quand le Soleil est las, et qu’il a fait sa tâche,/Il descend chez Thétis, et prend quelque relâche./C’est ainsi que Louis s’en va se délasser/D’un soin que tous les jours il faut recommencer. »

Portrait de Charles Perrault par Charles Le Brun (vers 1670)
© Charles Le Brun, Public domain, via Wikimedia Commons

Source : gallica.bnf.fr
Pour se représenter cette grotte, qui a été détruite en 1684 lors de la construction de l’aile nord du château, il faut se référer aux descriptions et aux illustrations disponibles dans des documents du XVIIe siècle comme, par exemple, le livre de l’historiographe André Félibien (1619-1695) : « Description de la grotte de Versailles »[1], ou les gravures de Jean Lepautre (1618-1682) enrichissant les versions luxueuses de cet ouvrage. Il existe également une toile anonyme représentant Louis XIV devant la grotte de Téthys, datée d'environ 1670.
Notons que, Téthys étant la grand-mère d’une belle Néréide nommée Thétis, la confusion orthographique entre les deux noms est fréquente, en particulier dans les textes du XVIIe siècle, tels ceux cités ci-dessus, mais pas seulement.
[1] Cet ouvrage de A. Félibien a paru en 1672 et 1674 dans des éditions modestes sans planches, puis en 1676 et 1679 dans des éditions luxueuses in folio comportant 48 gravures dont 20 consacrées à la grotte de Téthys.

Vue de la face extérieure de la Grotte de Versailles
Jean Lepautre, 1672
Louis XIV à cheval devant la grotte, suivi par Monseigneur et une partie de la cour dans les années 1670.
Anonyme.Collections du Château de Versailles. Domaine public

L’historien et conservateur du Château de Versailles, Alexandre Maral, résume ainsi les descriptions données de la grotte de Téthys : « Une sorte de loggia ouvrant par trois arcades sur les jardins et dont l’intérieur, animé de jeux d’eaux raffinés, fut tapissé de pierres et de coquillages, de nacre, de perles et de coraux, mais aussi de panneaux de miroirs. Les tritons et les néréides des parois, en nacre et en coquillages, symbolisaient l’univers marin dont le lieu était, en quelque sorte, un abrégé.
Un orgue hydraulique fut placé au fond de l’antre, à l’arrière de la niche centrale »
Le plan de la grotte dû à Jean Lepautre dans les versions illustrées du livre d’A. Félibien indique en effet l’orgue G à la place mentionnée ci-dessus.
À part ce plan, peu d’informations sont disponibles sur l’orgue, d’ailleurs invisible de l’intérieur de la grotte, et dont il n’existe pas d’image. Cela contraste avec les nombreux documents se rapportant aux trois groupes sculptés sur le thème d’Apollon, dieu associé au Soleil, qui occupaient les trois niches de la grotte [1]. Pour l’orgue, qui n’est pas une œuvre d’art mais un « simple » instrument destiné à participer aux somptueux divertissements offerts par le Roi à ses invités, on ne relève que des évocations de son concours au charme de la grotte, encore accru par les chants d’oiseaux.
[1] Ces groupes en marbre, réalisés entre 1665 et 1674, sont : Apollon servi par les nymphes de François Girardon et Thomas Regnaudin [allégorie de Louis XIV profitant des soins que requiert son état de fatigue en fin de journée], Les chevaux du Soleil pensés [sic] par les Tritons de Gaspard et Balthazar Marsy (groupe de droite) et Gilles Guérin (groupe de gauche). Après la destruction de la grotte en 1684, ces sculptures furent transférées au Bosquet des Dômes.
Par exemple, A. Félibien, après avoir évoqué « une infinité de petits oiseaux qui font un ramage très agréable par l’effet de l’eau », écrit :
« Mais lorsqu’au bruit de l’eau, le Jeu des Orgues s’accorde avec le chant des petits oiseaux dont j’ai parlé qui, par une industrie admirable, joignent leurs voix au son de cet instrument ; et par un artifice encore plus surprenant, l’on entend un Écho qui répète cette douce musique ; c’est dans ce temps là que par une si agréable symphonie les oreilles ne sont pas moins charmées que les yeux ».
Mademoiselle de Scudéry, quant à elle, dans La promenade de Versailles, paru en 1669, insiste sur l’association du visuel et de l’auditif dans le spectacle offert par l’animation de la grotte, lorsqu’on faisait « jouer les eaux » : « Les yeux sont ravis, les oreilles sont charmées. […] mille oiseaux de relief, parfaitement bien imités, trompent les yeux pendant que les oreilles sont agréablement trompées car, par une invention toute nouvelle, il y a des orgues cachés et placés de telle sorte qu’un écho de la grotte leur répond d’un côté à l’autre, mais si naturellement et si nettement que tant que cette harmonie dure, on croit effectivement être au milieu d’un bocage, où mille oiseaux se répondent, et cette musique champêtre mêlée au murmure des eaux fait un effet qu’on ne peut exprimer ».

Vue du fond de la Grotte de Versailles,
orné de trois groupes de marbre blanc, qui représentent le Soleil au milieu des Nymphes de Téthys, et ses chevaux pansés par des Tritons
Jean Lepautre, 1676
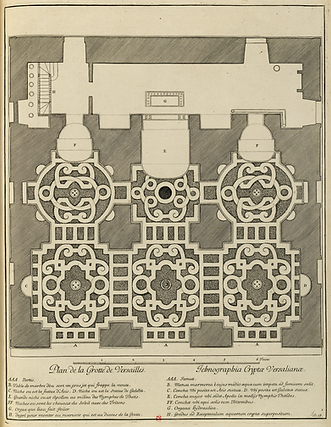
G
Plan de la Grotte de Versailles
Jean Lepautre dans l'ouvrage de A. Félibien de 1679
UN ORGUE ÉNIGMATIQUE
N’y avait-il vraiment qu’un seul orgue dont l’écho semble multiplier la voix, ou plusieurs comme semblent le suggérer l’emploi du pluriel dans les textes ci-dessus ? Sur ce point, le plan qui ne montre qu’un seul orgue donne la réponse. Souvenons-nous que l’utilisation du pluriel « orgues » se rencontre même pour désigner un unique instrument.
Par ailleurs, pourquoi qualifier cet orgue d’« hydraulique » comme le fait A. Maral à l’instar de divers auteurs ?
Enfin, quelle était la fonction exacte de cet orgue : imiter lui-même des chants d’oiseaux ou compléter par des mélodies les chants d’oiseaux produits par d’autres mécanismes ?
Pour tenter de répondre à ces questions, intéressons-nous d’abord au fonctionnement de l’orgue de la grotte de Téthys, aujourd’hui disparu.
Un orgue hydraulique ?
Sur le plan de J. Lepautre, légendé en français et en latin, l’orgue désigné par la lettre G correspond respectivement à : « Orgue que l’eau fait jouer » et « Organa hydraulica ». Notons que J. Lepautre n’a pas écrit « orgue hydraulique » en français. Avait-il conscience de l’ambiguïté de ce terme ?

Légende du plan de la Grotte de Versailles en français et en latin.
Jean Lepautre dans l'ouvrage de A. Félibien de 1679.
La lettre G correspond à l'orgue
En effet, « orgue hydraulique » désigne habituellement l’orgue antique tel qu’inventé par l’ingénieur grec d’Alexandrie, Ctésibios aux environs de 250 av. notre ère. Le terme orgue hydraulique ou hydraule n’apparait cependant dans les textes qu’au 1er s. de notre ère, chez Pline d'Ancien en latin, et chez Héron d'Alexandrie en grec. Sa racine grecque se décompose ainsi : instrument à vent (aulos) fonctionnant avec l’eau (udor ou hydor).
Deux descriptions en ont été données, respectivement, par Vitruve (architecte) dans De Architectura, et par Héron d’Alexandrie (ingénieur) dans Pneumatica. Dans chacun des textes, le vent destiné à alimenter les tuyaux d’orgue est produit, par une ou deux pompe(s) à pistons actionnées par des leviers, eux-mêmes manipulés par des assistants. Le vent arrive ensuite dans un dispositif contenant de l’eau qui joue le rôle de régulateur de la pression de l’air comme indiqué dans le schéma ci-dessous [1]. L’orgue antique est bien un instrument pneumatique comme tous les orgues, alors que l’appellation « orgue hydraulique », introduit une confusion. Cette appellation reste pourtant utilisée.
[1] Attention. Les informations données par Wikipedia à l’entrée « Orgue hydraulique » sont fausses.

Schéma de l'orgue hydraulique antique décrit par Héron d'Alexandrie dans Pneumatica (Les Pneumatiques), reproduit par Albert de Rochas.
Quoi qu’il en soit, l’orgue de la grotte de Téthys, « orgue que l’eau fait jouer », n’est donc en aucun cas un instrument analogue à l’orgue antique évoqué ci-dessus où l’eau n’a pas de rôle moteur. En revanche, cet orgue utilise l’action mécanique de l’eau. Comment fonctionne-t-il ? De quels modèles se sont inspirés les fontainiers de Versailles ?
Un orgue d'origine florentine ?
Le fontainier François Francine (1617-1688) était le deuxième membre de la dynastie des Francine à qui avait été octroyée, en 1623, la charge transmissible d’Intendants des Eaux et Fontaines du Roi. François était le fils de Thomas Francini (dit de Francine), ingénieur italien né à Florence en 1571. Ce dernier vint en France à la demande de Henri IV vers 1597 afin d’établir les jeux hydrauliques du château de Saint-Germain-en-Laye. Pouvait-il ignorer alors l’aménagement du parc de la Villa de Pratolino, situé à 12 km au nord de Florence et achevé en 1583 ? Peuplé de grottes, de bassins et de fontaines, le parc résonnait d’orgues et de chants d’oiseaux, mus par d’ingénieux dispositifs hydrauliques musicaux, décrits et expliqués, en outre, dans un ouvrage de référence paru au début du XVIIe siècle.
Il s’agit du livre de l’ingénieur français Salomon de Caus (1576-1626), qui avait visité les jardins de Pratolino, et qui avait publié en 1615 l’ouvrage en trois parties, intitulé : « Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utilles que plaisantes ausquelles sont adjoints plusieurs desseings de grotes et fontaines » (sic). Dans la première partie, il présente, illustrations à l’appui, diverses machines hydrauliques destinées à des effets d’eau et/ou de musique dans les jardins. Puis, dans la troisième partie, il traite de la fabrique des orgues actionnés par l’eau.
Dans tous les cas, des roues hydrauliques dont la rotation est provoquée par une chute d’eau placée au-dessus actionnent les dispositifs mécaniques associés à la soufflerie et/ou à la commande d’un clavier par un cylindre où sont fichées des chevilles.
Page de titre de l'ouvrage de Simon de Caus : "Les raisons de forces mouvantes ..."
(voir texte ci-dessus), 1615


Salomon de Caus
Ingénieur aux compétences multiples dont : l'architecture, l'hydraulique, la musique, la construction d'orgues...
Connu pour avoir été au service du Prince de Galles, puis du Prince électeur du Palatinat Friedrich V, pour lequel il a aménagé les jardins de son château d'Heidelberg de 1614 à 1620
© Public domain, via Wikimedia Commons

Table du 3e livre consacré à la fabrique des orgues actionnés par l'eau
de l'ouvrage de Simon de Caus : "Les raisons de forces mouvantes ..."
(voir texte ci-dessus), 1615
Ce sont les recherches de l’ingénieur Louis-Alexandre Barbet (1850-1931) qui ont définitivement établi l’influence italienne à Versailles, comme expliqué dans son ouvrage de 1907 à vocation technique sur les Grandes Eaux de Versailles. Ayant consulté les mémoires aux archives nationales, il a pu constater que les mouvements et les roues hydrauliques de l’orgue de la grotte de Téthys étaient identiques à ceux de Pratolino. Cet auteur fournit un croquis inspiré de ceux de Salomon de Caus, reproduit ci-dessous. Il est intéressant d'y joindre les gravures correspondantes du livre de S. de Caus avec les définitions telles que données par leur auteur.


"Machine par laquelle on fera sonner un jeu d'orgues par le moyen de l'eau"
S. de Caus, 1615

"Machine par laquelle les soufflets de la précédente se pourront hausser pour donner le vent aux tuyaux d'Orgues"
S. de Caus, 1615

"Représentation de la roue musicale [le cylindre] en plus grande forme"
S. de Caus, 1615
C’est donc le savoir-faire des ingénieurs italiens de la Renaissance, nourri de la redécouverte des travaux antiques sur l’hydraulique, qui a été mis en œuvre pour la construction de l’orgue de la grotte de Téthys. La réalisation en a été confiée au facteur d’orgues Desnots [1] à Montmorency, et l’installation a été faite par Denis Jolly en avril 1666. Les Comptes des Bâtiments du Roi révèlent que l’entretien de l’orgue s’avéra coûteux au cours des années.
[1] On lit dans Les Comptes des Bâtiments du Roi que la somme de 4000 livres a été payée en août 1673 aux héritiers du Sieur Desnots pour le coût de l'orgue.
Et les chants d’oiseaux ?
Du texte d’A. Félibien cité ci-dessus : « Le jeu des Orgues s’accorde avec le chant des petits oiseaux qui, par une industrie admirable, joignent leurs voix au son de cet instrument », il ressort que l’orgue ne produisait pas les chants d’oiseaux comme le fait une serinette mais que, tel un orgue à cylindre, il jouait les airs enregistrés sur son cylindre.
Il est vraisemblable que les chants d’oiseaux étaient produits également par des mécanismes hydrauliques analogues à ceux de Pratolino, largement décrits par Salomon de Caus et reproduits également par L.-A. Barbet [1]. Dans ces dispositifs, ce sont quelques tuyaux d’orgue qui restituent les notes du chant de l’oiseau. Après le schéma donné ci-dessous, on trouvera comme précédemment le dispositif dessiné par S. de Caus.
Notons que, dans certains cas, selon Salomon de Caus, le vent peut être conduit de la soufflerie propre de l’orgue aux tuyaux concernés par des porte-vent sans que de l’air soit stocké dans un réservoir comme ci-dessous.
[1] Notons que ces mécanismes avaient déjà imaginés dans l’Antiquité par Héron d’Alexandrie et décrits dans son ouvrage Pneumatica.


"Pour faire représenter plusieurs oiseaux lesquels chanteront diversement quand une chouette se tournera vers iceux, et quand la chouette se retournera, ils cesseront de chanter."
S. de Caus, 1615
Un instrument de musique mécanique
L’orgue de la grotte de Téthys était donc un instrument de musique mécanique pour lequel l’énergie nécessaire à son fonctionnement était fournie par l’énergie cinétique d’une chute d’eau. Cet instrument était en quelque sorte un des jeux d’eau de la grotte dont l’effet n’était pas visuel, mais musical.
Ainsi, associé aux chants d’oiseaux et à l’écho, dont on trouve également une description dans le livre de S. de Caus donnée ci-dessous, l’orgue a été l’origine des merveilleux effets sonores qui ont subjugué les contemporains.

Dessin d'une nymphe qui joue des orgues, à laquelle un écho répond
S. de Caus, 1615

Aparté concernant l’orgue de la Villa d’Este de Tivoli
Quelques mots à propos de l’orgue du parc de la Villa d’Este, proche de Rome, inauguré vers 1571 et dont la construction dans la Fontaine de l’Orgue est en partie due au fontainier français Luc Leclerc et à son neveu Claude Venard, spécialisé dans les orgues hydrauliques. Il comportait 22 tuyaux et semble avoir été un proche parent de l’orgue de la grotte de Téthys. Malgré plusieurs restaurations dès le XVIIe siècle dues à sa fragilité, l’orgue cessa définitivement de fonctionner au siècle suivant.
Une très importante restauration a permis de le faire jouer à nouveau depuis 2003. La majorité de ses éléments constitutifs a été reconstruite avec des matériaux actuels (inox, laiton) sur le modèle de l’époque. Avec 144 tuyaux et un cylindre programmable mu par l’eau, il peut jouer quatre pièces de musique Renaissance pendant quatre minutes, et émerveille à nouveau les visiteurs.
En revanche, l’orgue de la grotte de Téthys n’aura pas fonctionné plus de 18 ans, et aura disparu sans laisser d’autres traces que quelques documents. Ce petit article l’a fait revivre le temps d’une lecture.
Sources :
• Site internet sur les sculptures et les jardins de Versailles (auteur : Alexandre Maral)
• L'orgue hydraulique antique, Philippe Fleury, Schedae, Vol. 1, 2005, pp. 7-17
• Description de la grotte de Versailles, André Félibien, à Paris, 1672, 1674, puis édité avec planches en 1676 et 1679, éditions parues sans mention du nom de l’auteur
• La promenade de Versailles dédiée au Roi, suivie de l'Histoire de Célanire, Madeleine de Scudéry (1607-1701), chez Claude Barbin à Paris, 1669, édition parue sans le nom de l'auteur
• La Science des Philosophes ou l'Art des Thaumaturges dans l'Antiquité, Albert de Rochas, Paris, Masson, 1882
• Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utilles que plaisantes ausquelles sont adjoints plusieurs desseings de grotes et fontaines, Salomon de Caus, Francfort, Jan Norton, 1615, 1624
• Les grandes eaux de Versailles : installations mécaniques et étangs artificiels, description des fontaines et de leurs origines, Louis-Alexandre Barbet, Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1907
• Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV. Tome premier, Colbert, 1664-1680, publié par M. Jules Guiffrey, Imprimerie Nationale (Paris), 1881-1901
Source de tous les ouvrages : gallica.bnf.fr

L'ORGUE DE PAPIER
Quelle image fait naître en nous le mot « orgue » ? D’ailleurs quelle en est la racine ? Venant du grec « Organon », signifiant « outil, instrument », le mot « orgue » fut originellement employé pour désigner tout instrument de musique.
Aujourd’hui, un orgue est traditionnellement l’instrument à vent qui a évolué durant des siècles, composé de tuyaux, chacun étant accordé à une seule note. Ils « parlent » à condition d’être alimentés par le vent d’une soufflerie, dont l’arrivée est commandée par les claviers et un mécanisme complexe. La vibration de l’air, communiquée au matériau du tuyau, est à l’origine du son émis. Les tuyaux de timbres identiques sont regroupés en familles, les jeux. Chaque jeu est en quelque sorte un instrument individuel (flûte, bombarde, trompette, etc.) et la combinaison des jeux ouvre un espace infini de sonorités dues au timbre de chaque tuyau dont le son fondamental est enrichi de ses harmoniques.

Jeux du positif de dos de l'orgue de Notre-Dame de Beaune
_edited.jpg)
François-Xavier Richard
Créateur de "L'orgue de papier"
Fondateur de l'Atelier D'OFFARD à Tours
(© d'Offard)
Un tel instrument éveille l’imagination créatrice. Ainsi, l’artiste François-Xavier Richard [1], explorant les multiples potentialités du papier, a créé un orgue inattendu, « l’Orgue de papier ». Il a imaginé et réalisé cet orgue en 2017 lors de sa résidence à la Villa Kujoyama [2] à Kyoto, dont il a été lauréat (catégorie « Métiers d’Art »), le projet étant soutenu par la Fondation Bettencourt-Schueller.
[1] François-Xavier Richard est spécialiste du papier peint imprimé à la planche et fondateur en 1999 de l’atelier D’OFFARD à Tours (site internet accessible à la fin de ce billet).
[2] La Villa Kujoyama est un établissement artistique français qui accueille à Kyoto, depuis 1992, des artistes, des créateurs et des designers pour promouvoir la création contemporaine. Il est destiné à favoriser les échanges entre la France et le Japon et est l’équivalent de la Villa Médicis à Rome.
« L’Orgue de papier » est un assemblage de « jeux » dont le son est obtenu par divers moyens de « faire chanter » du papier « washi [1]», matériau traditionnel japonais. Ce papier, fabriqué artisanalement à la main au Japon, présente une résistance mécanique exceptionnelle et une rigidité qui favorise la propagation des vibrations sonores.
[1] Ce papier est fabriqué à partir de longues fibres, provenant le plus souvent de l'écorce des tiges du mûrier à papier, trempées dans de l’eau, épaissies, puis filtrées à l’aide d’un tamis. Il a été inscrit en 2014 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (https://ich.unesco.org/fr/RL/le-washi-savoir-faire-du-papier-artisanal-traditionnel-japonais-01001 ).

Lampe réalisée
en papier washi japonais
© L'attribut-lumière, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Les jeux sont individuellement des instruments constitués d’objets dont le rendu sonore (chuchotements, froissements, crissements, claquements, etc.) est associé aux mouvements communiqués par les musiciens au papier qui a été découpé, plié, tendu… et à la forme qu’il a acquise. Il a été attribué à ces jeux des noms évocateurs : crécelle, pédalier de fouets, claquetier, méduse, moulin, shadok, harmonica… Leur assemblage est réalisé sur une large structure modulaire en bois inspirée par l’architecture traditionnelle japonaise. Un pédalier également en bois permet d’actionner divers instruments.

Exemples de jeux de l'Orgue de papier
Photos © Plumecocq
Images extraites du Dossier sur l'orgue de l'atelier D'OFFARD
CONCEPTION GRAPHIQUE :
LOUIS RICHARD MARSCHAL


Schéma de la structure en bois où sont assemblés les jeux
Dimensions : 9 m x 7 m x 2,50 m de hauteur
Image extraite du Dossier sur l'orgue de l'atelier D'OFFARD
CONCEPTION GRAPHIQUE :
LOUIS RICHARD MARSCHAL
Le vaste ensemble musical obtenu (« Organon » au sens étymologique) combine les multiples effets sonores dus aux jeux comme un orgue à tuyaux le fait avec les timbres. Néanmoins, on est loin de l’immobilisme apparent des tuyaux que l’organiste fait parler… Ici, l’orgue doit être compris « comme un espace scénique où les musiciens feront corps avec l'instrument, entre chorégraphies, percussions et recherches sonores » comme l’exprime son créateur.
L’orgue de papier a été présenté et activé pour la première fois au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2021. F.-X. Richard a bénéficié de l’aide de Seijiro Murayama et de Frédéric Blondy (eux-mêmes lauréats à la Villa Kujoyama, respectivement en 2016 et 2017, dans la catégorie « Musique »).
Vidéo de l’installation au Musée de la Chasse et de la Nature : https://www.youtube.com/watch?v=yJLbaldLuss
En 2025, c’est un « Orgue de papiers » qui a été mis en scène en mai à la Grange des dîmes de Fondettes (Indre-et-Loire) par Muriel Marschal et Simon Plumecocq, à l’occasion d’une performance évoquant un texte japonais du VIIIe s., le Kojiki. En outre, de juin à août, cet instrument a été à nouveau présenté à l’Hôtel Goüin de Tours (Indre-et-Loire), où l’atelier D’OFFARD a célébré ses 25 ans lors d’une exposition se terminant le 31 août par une conférence et la performance de l’orgue.
.jpg)
Hotel Goüin, Tours
© Angelo Brathot from Sologne-France, CC0, via Wikimedia Commons
La conception d’une telle œuvre s’inscrit dans la démarche d’un artisanat d’art qui entend donner au papier toutes ses lettres de noblesse, à l’époque où le numérique le fait disparaître en tant que support de l’écriture. On ne peut que se réjouir de voir cette création polyphonique se référer, par son nom même, à l’orgue.
Ce clin d’œil vous est présenté avec la bienveillante autorisation de l’Atelier D’OFFARD, et grâce aux documents que Simon Plumecocq m’a aimablement fournis et permis d’exploiter. Un grand merci à eux !
Pour en savoir plus sur l'Atelier D'OFFARD :
• Site Internet de l'atelier D'OFFARD, cliquer ici.
• Reportage du 11 mars 2022 (3 min.) sur Radiofrance (ici), cliquer ici.

WILLIAM HERSCHEL (1738 - 1822)
L'ORGANISTE QUI A REPOUSSÉ LES LIMITES DU CIEL
L’histoire que vous allez découvrir se déroule en Angleterre au XVIIIe siècle, principalement sous George III qui a régné de 1760 à 1820. Ce roi, le troisième de la maison de Hanovre, est très cultivé, collectionneur de livres et féru de sciences. En dépit de sa maladie mentale intermittente et des turbulences politiques qui marquent son règne, George III se comporte en monarque éclairé. Par ses libéralités vis-à-vis de W. Herschel, il est un acteur primordial des progrès colossaux que ce dernier a fait accomplir à l’astronomie.
N.B. Les encadrés que comporte ce document
sont placés à la fin
La découverte d’Uranus par William Herschel, organiste à Bath
Imaginez-vous à Bath, dans le comté du Somerset, au sud-ouest Angleterre, pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette ville de cure, connue depuis l’époque romaine pour ses eaux chaudes est alors le lieu à la mode, affectionné de l’aristocratie anglaise, comme de la grande bourgeoisie.

Le grand bassin
des thermes romains de Bath
© Diego Delso, CC BY-SA 4.0
via Wikimedia Commons
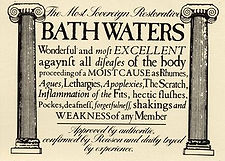_edited.jpg)
Publicité pour les eaux de Bath (18e s.)
« Les eaux de Bath : les plus souverainement réparatrices. Merveilleuses et excellentes contre toutes les maladies du corps causées par l'humidité, tels que rhumes, fièvres, léthargies, apoplexies, démangeaisons, convulsions, bouffées de chaleur, abcès, surdité, pertes de mémoires, tremblements et faiblesse de tout membre.
Approuvé par les autorités, confirmé par la Raison et testé quotidiennement par l'expérience ».

BATH
On y vient pour se soigner autant que pour se divertir, se montrer aux bals et aux concerts et participer aux mondanités. Les curistes fortunés évoluent entre la Pump Room (buvette) et les Assembly Rooms (salons destinés aux fêtes). Autant dire que le beau monde fréquentant Bath, et ses manières, sont du bon pain pour les caricaturistes, comme vous le constatez sur les gravures jointes.

The Pump Room (la buvette)
De nombreux malades de la goutte
ont de gros pansements sur les jambes
Deux aquatintes extraites de "Comforts of Bath",
Thomas Rowlandson (1798)
© Thomas Rowlandson,
Public domain, via Wikimedia Commons


The Concert (le concert)
(noter la coiffure de la chanteuse, cf. gravure ci-dessous)
"A modern belle going to the rooms at Bath"
(Une belle à la page se rendant aux salons de Bath)
Caricature by James Gillray, 1796, se moquant de la dernière mode où les femmes plantent une ou deux grandes plumes verticalement dans leur coiffure.
© James Gillray, Public domain, via Wikimedia Commons
Ainsi, rien ne prédestine a priori ce lieu à être celui où se fera, le 13 mars 1781, une des plus grandes découvertes de l’astronomie d’alors, celle de la planète Uranus observée grâce à un télescope [1]. Aucune planète n’avait alors été découverte depuis l’Antiquité. De façon non moins surprenante, l’auteur de cette découverte est l’organiste qui a été engagé en 1766 à Bath pour jouer l’orgue de la toute récente « Octagon Chapel » (Chapelle octogone) : (Frederick) William Herschel.
[1] La nature d’Uranus n’avait jamais été perçue jusqu’à présent car, deux fois plus éloignée du Soleil que Saturne, elle est quasiment invisible à l’œil nu contrairement aux planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne observées depuis l’Antiquité. Les quelques observations antérieures d’Uranus avec des lunettes l’avaient fait classer au rang de possible étoile en mouvement.

Planètes du Système Solaire par ordre d'éloignement du Soleil
(échelle non respectée ; en particulier, Uranus est deux fois plus éloignée du Soleil que Saturne).
Neptune ne sera observée qu'en 1846, là où des calculs l'avaient prédit.

William Herschel par L.F. Abbott en 1785
(Herschel est âgé de 46 ans)
National Portrait Gallery, Londres
© Lemuel Francis Abbott, Public domain,
via Wikimedia Commons
Astronome amateur, captivé par le ciel nocturne et son observation, William Herschel a construit lui-même le télescope de 7 pieds [2] qui est l’outil de la découverte. L’original a disparu, mais on peut en voir une réplique au Herschel’s Museum (Musée Herschel) qui se trouve au 19, New King Street à Bath, adresse du domicile où Herschel venait d’emménager lors de sa découverte.
[2] Distance focale de 210 cm, grossissement 227.

Entrée du Herschel's Museum
(Musée Herschel)
19, New King Street, Bath
Lieu de la découverte d'Uranus
© Roger Jones / William Herschel Museum, Bath

Réplique du télescope de 7 pieds
qui a permis à W. Herschel de découvrir Uranus
(Herschel’s Museum)
© Mike Young, Public domain,
via Wikimedia Commons
La musique pour vivre et l'astronomie pour se réaliser
D’origine allemande, W. Herschel (dont le prénom allemand est Friedrich Wilhelm) est né en 1738 à Hanovre dans une famille de musiciens militaires. Il joue très tôt du violon et de l’orgue, et à 14 ans, il est engagé dans la Garde Hanovrienne en tant qu’hautboïste, comme le fut son père. Par ailleurs, William acquiert de bonnes connaissances générales (latin, mathématiques, langues, philosophie) à l’école de la garnison. L’invasion du Hanovre par la France au début de la Guerre de Sept Ans le conduit à émigrer en Angleterre en 1757 avec son frère aîné de quatre ans, Jacob, organiste.
Pendant neuf ans, il doit mener une existence quelque peu nomade pour vivre de ses talents de musicien et de compositeur [3], entre autres pour l’orgue (voir encadré). Ambitionnant d’acquérir un poste fixe, il se perfectionne dans la pratique de cet instrument afin de passer le concours de recrutement d’un organiste à Halifax en août 1766. Il s’agit de tenir l’orgue neuf construit par le célèbre facteur suisse John Snetzler dans l’église Saint-Jean-Baptiste. Sa prestation marquante lui vaut d’être choisi parmi les sept candidats (voir encadré).
[3] William Herschel a composé 24 symphonies, des concertos pour hautbois, violon et alto, ainsi que pour orgue, des sonates, de la musique d’église et beaucoup de pièces destinées à l’orgue.

Manuscrit de la Symphonie No. 15 in mi bémol majeur, composée par
William Herschel en 1762.
Transcrite de la main du compositeur
© British Library Add MS 49626
Simultanément, Herschel apprend son engagement à Bath comme futur organiste de l’« Octagon Chapel », une chapelle privée nouvellement bâtie dont Snetzler doit construire l’orgue (voir encadré). Le prestige dont jouit Bath ne le fait pas hésiter. Il quitte Halifax en novembre 1766, au bout de seulement trois mois de fonction. Le 1er janvier 1767 à Bath, Herschel témoigne de sa polyvalence musicale lors d’un concert de bienfaisance où il joue un concerto pour violon, un autre pour hautbois et une sonate pour clavecin, œuvres majoritairement de sa composition. Très rapidement, il est invité à rejoindre les orchestres de l’Assembly Room, de la Pump Room et du théâtre.
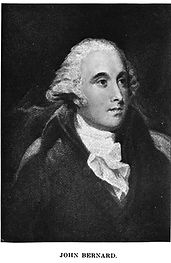
John Bernard (1756 - 1828)
Acteur et biographe
Secrétaire du Beef-Steak Club [4]
© Franklin Graham, Public domain,
via Wikimedia Commons
Page de titre des Mémoires de J. Bernard (publication posthume en 1832)
Bien que disposant à Bath d’une rémunération assurée, Herschel continue, comme auparavant, de tirer une partie de ses revenus des cours de musique qu’il dispense même si cette activité lui pèse de plus en plus. L’acteur John Bernard (1756-1828), qui a pris des cours de chant avec lui dans les années 1785-86, raconte dans ses mémoires "Retrospections of the stage" (Souvenirs de la scène) que son professeur a refusé de se faire payer, ce qui traduit le désintéressement de ce dernier et/ou le meilleur confort financier dont il dispose dorénavant.

L’acteur livre quelques témoignages anecdotiques à propos de son professeur, par exemple : « Son logement ressemblait beaucoup plus à celui d'un astronome qu'à celui d'un musicien, étant encombré de globes, de cartes, de télescopes, de réflecteurs, etc., sous lesquels le piano était caché, le violoncelle étant, tel un favori abandonné, caché dans un coin ». John Bernard rapporte aussi que Herschel, considéré comme excentrique par ses collègues, restait parfaitement imperméable aux plaisanteries dont il était l’objet et, qu’en société, il était perpétuellement distrait. On souriait de son inattention « Il est de nouveau dans les nuages, il regarde les étoiles ! ».
[4] “Beef-steak Club” désigne un club (parmi d’autres) réservé aux gentlemen masculins britanniques aux 18e et 19e siècles qui prônent le beefsteak en tant que symbole patriotique, lié aux concepts « Whig » de liberté et de prospérité. On y rencontrait, non seulement des politiques, mais aussi des acteurs et des personnalités du monde du spectacle.
C’est à partir de 1773, qu’Herschel s’attelle, avec un constant souci de perfection, à la fabrication de ses propres lunettes et télescopes. Pour ces derniers, il coule les alliages métalliques destinés aux miroirs qu’il taille et polit de ses propres mains. Il commence également à s’instruire en astronomie, alors qu’il avait surtout travaillé les mathématiques en autodidacte jusqu’à présent. Membre en 1779 d’une société savante de Bath qui promeut la recherche scientifique, il apprend à rédiger des publications scientifiques destinées aux membres de cette société. En 1781, trois de ses articles sont même publiés par la Royal Society dans les Philosophical Transactions [5].
[5] La « Royal Society » est l’équivalent de l’Académie des Sciences. Les « Philosophical Transactions » sont une publication scientifique à vocation internationale de la Royal Society, deuxième journal scientifique publié dans le monde. L’adjectif Philosophical (philosophique) se réfère à la science, alors appelée « philosophie naturelle », alors que le nom Transactions signifie « travaux » ou « actes ».

Sir William Herschel et Caroline Herschel
Lithographie en couleurs de A. Diethe, ca. 1896
William polit un miroir de télescope et Caroline ajoute le lubrifiant
Lors de ses observations, William Herschel est assisté de sa jeune sœur Caroline qu’il a ramenée à Bath en 1772 ; elle est elle-même musicienne et chanteuse, tout en ayant été instruite en mathématiques par son frère. Mais en mars 1781, pour la découverte d’Uranus, Caroline n’est pas présente. Quel regret pour elle !
Elle deviendra néanmoins une astronome confirmée à qui on doit la découverte de huit comètes entre 1786 et 1797.

Plaque de Rue, à Paris
Rue située non loin de l'Observatoire
© Chabe01, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Caroline Herschel
jeune astronome (bas)
et devenue âgée (haut)
Illustration p. 33 du livre "Women Worth Emulating" ("Des femmes exemplaires"),1877
© Clara L. Balfour, Public domain, via Wikimedia Commons
En 1781, c’est d’ailleurs une comète que Herschel pense d'abord avoir observée et c’est ainsi qu’il présente sa découverte à la Royal Society au mois d’avril. Cependant, après les investigations d’autres astronomes avec qui il est en relation, il se corrige en 1783 auprès du président de cette Société : « Il semble que la nouvelle étoile, que j'ai eu l'honneur de…signaler en mars 1781, est une planète primaire de notre Système solaire » (voir encadré).
Voilà ainsi reculées les limites de notre Système Solaire dont l’étendue supposée se limitait alors à Saturne, c’est une fabuleuse avancée des connaissances !
De la « construction des cieux » à la reconnaissance internationale
La réputation de William Herschel devient alors telle que le Roi George III, passionné de science et en particulier d’astronomie, décide de l’associer aux travaux de son propre observatoire situé près du jardin botanique de Kew, à l’ouest de Londres. Il le nomme « astronome du roi ». Souhaitant le voir quitter Bath pour se rapprocher de Windsor, il lui alloue, ainsi qu’à sa sœur, une pension et complète en le rétribuant pour la construction de télescopes.
Herschel accepte l’offre du Roi, et abandonne la vie de musicien professionnel qu’il a pratiquée pendant une trentaine d’années. En 1782, il part habiter près de Windsor, puis en 1786 à Slough à l’ouest de Londres. C’est là qu’il se marie en 1788 et qu’en 1792 naît son fils John, futur grand astronome.

George III
en costume de Couronnement
peint par Allan Ramsay vers 1765
© Allan Ramsay, Public domain, via Wikimedia Commons
William découvrira des centaines de nouveaux objets célestes, au-delà même de la Voie Lactée. En 1785, il publie un article intitulé « De la construction des cieux [6]» où apparaît la dimension du « temps » dans l’Univers, posant la question de l’évolution de ce dernier et de celle des objets célestes, selon une organisation à découvrir. Il revient sur son objectif dans le mémoire qu’il publie en 1811 dont la première phrase est : « Avoir une connaissance de la construction des cieux a toujours été le but ultime de mes observations [7] ».
[6] « On the Construction of the Heavens », Philosophical Transactions 1785, Vol. 75, pp. 213-266. On peut notamment lire : « Le ciel ressemble à un jardin luxuriant renfermant la plus grande variété de productions, à des états différents de leur existence, et son examen actuel nous permet d’étendre notre expérience à une immense durée. »
[7] « Acknowledge of the construction of the heavens has always been the ultimate object of my observations …» dans « Astronomical Observations relating to the Construction of the Heavens, … », Philosophical Transactions 1811, Vol. 101, pp. 269-336.

Sir John F. W. Herschel (1792 - 1871)
par W. Ward, 1835
© W. Ward, Public domain, via Wikimedia Commons
Les structures mentales qu’Herschel a acquises par sa grande pratique de la musique, avec organisation et rigueur, ont sans doute été déterminantes pour concevoir l’Univers à partir de ses observations. Il a ouvert la voie vers le monde stellaire et a ensemencé la réflexion d’autres astronomes, contemporains comme Pierre Simon Laplace (1749 - 1827) et futurs, à commencer par son propre fils John Herschel.
Par ailleurs, en 1800, Herschel, qui étudie les radiations solaires, a l’intuition de la présence d’un rayonnement invisible engendrant de la chaleur, différent du rayonnement lumineux : il découvre ainsi le rayonnement infra-rouge (ainsi nommé ultérieurement).
Parallèlement à ses observations et à ses interprétations novatrices, Herschel construit les nombreux télescopes qui lui sont commandés de toute part en Europe. En Angleterre, il fait construire de 1785 à 1789, le télescope gigantesque de quarante pieds [8] dont il rêve, qui est alors le plus grand télescope du monde, financé par le Roi. Pourtant, cet extraordinaire télescope sera autant une attraction touristique qu’un outil de découverte, car lourd à manœuvrer, il nécessite plusieurs intervenants simultanément. Il lui a cependant permis de découvrir deux nouveaux satellites de Saturne, Encelade et Mimas, respectivement en août et septembre 1789. Cet instrument sera démantelé en 1840.
[8] Distance focale de 12 mètres
Herschel est devenu célèbre, il correspond avec des astronomes dans toute l’Europe.
En 1802, il est élu associé étranger de l’Académie des Sciences en France, puis élu membre en 1816. De nombreuses Académies des Sciences européennes l’accueillent également.
C’est aussi en 1816 qu’il est anobli.
En 1821, il devient le premier président de la « Royal Astronomical Society » (Société Royale d’astronomie) fondée en 1820.

Sir William Herschel en 1820
Âgé de 81 ans
par William Artaud
Collections du Royal Museums Greenwich
© William Artaud, Public domain,
via Wikimedia Commons

Armoiries de William Herschel
© Phoebe Allen, Public domain,
via Wikimedia Commons
Au centre : le télescope de 40 pieds, surmonté du symbole astronomique de la planète Uranus (sur fond bleu)
La devise est : "Cœlis Exploratis" (Ayant exploré les cieux)
Le grand téléscope de quarante pieds
construit de 1785 à 1789
Le tube (de 12 m de long et 1,47 m de diamètre, selon F. Arago) fut confectionné en premier et devint l’objet de visites. Le grand divertissement était de le traverser de part en part, ce que firent le Roi, la Reine et des notables en août 1787. Le Roi entraîna l’archevêque de Canterbury avec ces mots :
« Venez, Monsieur L’Évêque, je vais vous montrer le chemin vers le Ciel ».
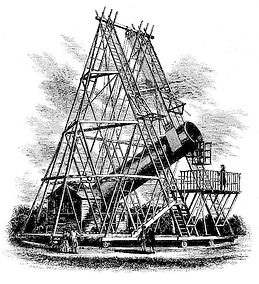
William Herschel termine ses jours à Slough en 1822.
Sur sa tombe est inscrite l’épitaphe : « Coelorum perrupit claustra »
« Il a franchi les barrières des cieux »
LES COMPOSITIONS POUR ORGUE DE WILLIAM HERSCHEL
William Herschel a composé pour l’orgue au moins deux concertos et de nombreuses pièces courtes. Dans le Dictionnaire des compositeurs, Dominique Proust, astrophysicien et organiste, a recensé les recueils suivants : 6 fugues, 24 sonates (dont 10 sont perdues), 32 « voluntaries » et autres pièces (incomplet), 24 autres pièces (incomplet), 12 « voluntaries » (11 perdus).
Les « voluntaries » sont des pièces courtes de tradition anglaise, généralement pour orgue et en deux mouvements, destinées à être jouées au début et à la fin des offices religieux anglicans. Elles devaient paraître improvisées comme l’indique leur nom, « voluntary » signifiant « spontané ».
Dominique Proust a enregistré un disque avec onze pièces courtes (fugues, allegros et préludes) en 1992. Récemment, le 21 juin 2025, il a donné un concert sur l’orgue de Marcel Dupré à Meudon, où il a interprété un « voluntary » de Herschel.


Page de titre et premier prélude du recueil de 32 voluntaries dont deux n’ont pas été copiés
(de la main de William Herschel ou de celle d’un copiste ?)
LE CONCOURS POUR LE POSTE D'ORGANISTE À HALIFAX EN 1766
Sept candidats postulaient en 1766 au poste d’organiste à l’église Saint-Jean-Baptiste d’Halifax, dont le Dr Wainwright et W. Herschel, alors âgé de 28 ans. Le jury comprenait le facteur de l’orgue neuf, John Snetzler, très réputé pour la qualité de ses tuyaux. L’orgue ne comportait pas de pédalier dont l’utilisation était encore très exceptionnelle en Angleterre (et ce jusqu’au milieu du 19e siècle).
Lors de la prestation de Wainwright, Snetzler arpentait l’église, très agacé, maugréant : « Il court sur les touches tel un chat, ne laissant pas le temps à mes tuyaux de parler ».
En revanche, W. Herschel fit résonner l’orgue avec une telle plénitude que le jury l’élut aussitôt. Pour obtenir un tel effet, Herschel, qui déplorait l’absence de pédalier déjà présent dans les orgues allemands, avait déposé deux morceaux de plomb sur le clavier pour maintenir abaissées les touches correspondant aux notes graves, donnant l’impression « de jouer à quatre mains plutôt qu’à deux ».

Église Saint-Jean-Baptiste d'Halifax (2008)
© Alexander P Kapp / Halifax Parish Church, St John the Baptist, CC-BY-SA 2.0
Cette chapelle octogonale a été conçue par Timothy Lightholder avec le souci d’offrir le maximum de confort aux riches fidèles qui la fréquenteraient. Le bâtiment ne possède pas de façade sur la rue ; à l’époque, on y accédait par un passage au niveau des numéros 43-46 de Milsom Street.
Une galerie, où l’orgue fut installé, surplombe le rez-de-chaussée. La lumière provient des fenêtres de cette galerie et d’un lanternon au sommet du dôme. Les « bancs » destinés aux fidèles étaient quasiment des petits salons privés, chauffés de surcroît, que les curistes fortunés louaient pour leur séjour.
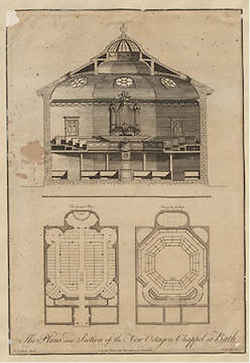
Plans et sections de la Chapelle octogone à Bath
Fin de sa construction en 1766
Le 4 octobre 1767, lorsque l’orgue construit par John Snetzler fut terminé, la chapelle s’ouvrit aux offices. On la présenta comme « le seul lieu de culte sécurisé à Bath ne comportant ni marches à monter, ni corps enterrés en-dessous ». En réalité, les caves voûtées étaient utilisées pour stocker du vin, ce qui fit écrire au poète Christopher Anstey : « Les esprits au-dessus sont des esprits Divins, les esprits au-dessous sont les esprits du vin (…soit les spiritueux) » [8]…
[8] “The spirits above are spirits Divine, The spirits below are spirits of wine”.
Lors de l’inauguration de l’orgue, le 29 octobre, William Herschel donna Le Messie de Haendel ; il dirigeait l’orchestre et son frère Jacob tenait l’orgue, les chœurs ayant leur propre chef. Entre les actes William joua en outre un concerto pour orgue.
Ce bâtiment fut utilisé en tant que chapelle jusqu’en 1895, et connut ensuite d’autres destinations (showroom d’un antiquaire, expositions, restaurant, etc.).
"THE OCTAGON CHAPEL" (LA CHAPELLE OCTOGONE) DE BATH, ET SON ORGUE
URANUS

Appelée par William Herschel Georgium Sidus (l’Étoile Géorgienne), en l’honneur du roi Georges III, cette planète prit le nom définitif d’Uranus en 1850. Ce nom a été suggéré et défendu par l’astronome allemand Johann Elert Bode, directeur de l’observatoire de Berlin. En effet, d’après la mythologie, Uranus est le père de Saturne, qui est lui-même le père de Jupiter.
La planète Uranus est une planète géante, gazeuse et glacée. Son diamètre est quatre fois supérieur à celui de la Terre. Elle est située à 2,87 milliards de km du Soleil, soit 18 fois la distance Terre-Soleil. Cela en fait la septième planète par ordre d’éloignement du Soleil après Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne (cf. figure ci-dessus). Sa période de révolution autour du Soleil est de 84 années terrestres. Son déplacement très lent explique la difficulté à l’identifier en tant que planète, comme mentionné ci-dessus.
Uranus est entourée de 28 satellites naturels (lunes) et de 13 anneaux. Deux de ses lunes ont été découvertes en 1787 par William Herschel : Oberon et Titania.
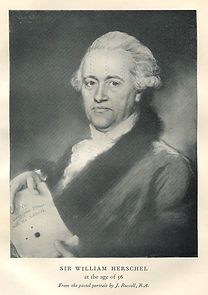
William Herschel en 1794 (âgé de 56 ans)
D'après le portrait réalisé par John Russell
Ce portait est un hommage à la découverte d'Uranus et de deux de ses satellites par W. Herschel. Sur le papier tenu par Herschell, on voit le dessin de la planète avec les deux satellites. Il est mentionné : « The Georgian Planet with its Satellites » (La planète géorgienne avec ses satellites).
Sources :
• The Herschel Chronicle. The life-story of William Herschel and his sister Caroline Herschel, edited by his granddaughter Constance A. Lubbock, Cambridge University press, 1933.
[Chronique Herschel. Histoire de la vie de William Herschel et de sa sœur Caroline Herschel, rapportée par sa petite-fille Constance A. Lubbock]
• William Herschel, musicien et astronome, Ronald Lessens, Éditions Burillier, Vannes, 2004
• Exploration du “Herschel Museum of astronomy” (en anglais) : https://herschelmuseum.org.uk/explore/
Ce musée est situé au 19, New King Street à Bath, adresse de l’habitation où Herschel a découvert Uranus.
• Retrospections of the stage, Vol. 2, John Bernard, Carter and Hendee, 1832 (publication posthume), pp. 37-40.
• The story of the organ, C. F. Abdy Williams, London, The Walter Scott Publishing Co., Ltd ; New York, Charles Scribner’s Sons, 1903, p. 182.
• Herschel, William (1738-1822), Dominique Proust, Dictionnaire des Compositeurs, Encyclopædia Universalis, 2015, p. 1255.
L'ORGUE DE PAULINE ET SA SINGULIÈRE DESTINÉE
Qui est Pauline ?
Pauline Garcia, épouse Viardot (1821-1910) est une légende de l’art lyrique du XIXe siècle. Sollicitée par les plus grandes scènes d’opéra de France et d’Europe, elle est l’amie, et même la muse, de nombreux compositeurs et musiciens célèbres. Le salon qu’elle et son mari, Louis Viardot, tiennent chaque semaine entre 1850 à 1880 environ est fréquenté par l’élite culturelle de l’époque, tant artistique que littéraire.
Fille d’un ténor et professeur de chant espagnol, elle bénéficie d’une excellente éducation, en particulier musicale. C’est une pianiste accomplie qui a été l’élève de Liszt et qui joue remarquablement du piano, selon Chopin et Saint-Saëns. Elle pratique aussi l’orgue et se plaira à composer pour la voix.

En 1836, le décès accidentel de sa sœur, la célèbre cantatrice Maria-Felicia Malibran de 13 ans plus âgée qu’elle, décide de son avenir : elle suivra les traces de son aînée dont elle possède la tessiture : mezzo-soprano très étendue. Son succès est dû, tant à l’originalité de sa voix à « la saveur de l’orange amère » selon Saint-Saëns, qu’à l’intelligence et le talent avec lesquels elle incarne ses rôles.

Portrait de Pauline Viardot en 1840
Musée de la Vie Romantique
Peinture d'Ary Scheffer (1795-1848)
© Ary Scheffer, Public domain, via Wikimedia Commons
Portrait de Maria-Felicia Malibran,
dite La Malibran
Mémoires de Louise Héritte-Viardot
Stock, 1923
Pauline compte de très chers amis musiciens : Clara Wieck (épouse de Robert Schumann à partir de 1840), Frédéric Chopin, Franz Liszt, etc. S’y ajoutent des grandes personnalités de l’art, tel Eugène Delacroix, et des lettres, comme George Sand qui la prendra pour modèle pour le personnage de Consuelo. Sans compter le très cher Ivan Tourgueniev, grand admirateur de Pauline, qui ne quittera guère le couple Viardot à partir de 1847.
C’est d’ailleurs George Sand, très attachée à Pauline et souhaitant voir s’épanouir son talent dans les meilleures conditions, qui arrange son mariage avec Louis Viardot, pourtant de 21 ans plus âgé. G. Sand connaît le dévouement et la culture de cet homme de lettres, journaliste et critique d’art. De fait, il quitte son poste de directeur du théâtre des Italiens pour se consacrer à la carrière de son épouse. Le couple, marié en 1840, s’accorde harmonieusement jusqu’au décès de Louis en 1883 qui est pour Pauline une épreuve extrêmement douloureuse.

Portrait de Louis Viardot
(Galerie de la Presse)
Anonyme, dessinateur-lithographe
CC0, via Wikimedia Commons
L’orgue de Pauline, rue de Douai, de 1851 à 1863
En 1848, les Viardot font construire un hôtel particulier rue de Douai, à proximité de l’actuel square Berlioz, dans le 9e arrondissement de Paris. (Hector Berlioz, ayant habité au 4, rue de Calais, de 1856 à son décès en 1869, fut leur très proche voisin*).
* Louise Héritte-Viardot rapporte dans ses Mémoires : « Berlioz demeurait tout près de notre hôtel ; il venait journellement épancher son cœur et chercher chez nous un peu du calme que l'humeur acariâtre de sa femme ne lui laissait pas chez lui. »
Des documents attestent qu’en 1850 un orgue, commandé par Pauline Viardot et destiné à ce logement, est en construction dans les ateliers Cavaillé-Coll situés alors rue Pigalle. La cantatrice se rend fréquemment dans les ateliers pour évaluer l’avancement des travaux. C’est, pour Aristide Cavaillé-Coll, le quatrième orgue commandé par et pour des particuliers, mais c’est le premier véritable orgue de salon. Sa console est séparée du buffet et retournée de façon à ce que l’organiste soit face à l’auditoire. La réalisation de cet orgue est minutieuse et raffinée. Le coût de l’instrument s’avère conséquent comme le révèlent les propos que Pauline tient pour la revue Musica en 1907 : « J’avais un bel orgue alors dans mon petit hôtel de la rue de Douai. J’avais vendu tous mes bijoux rapportés de Russie pour faire construire cet orgue par Cavaillé.»

Revue Musica (Juin 1907, n°57)
numéro consacré à Camille Saint-Saëns
P. Viardot confie ses souvenirs dans un article
sur la jeunesse de ce musicien qui fut un de ses grands amis.
© agorha.inha
Cet instrument, chéri de Pauline, animera le rendez-vous musical et mondain des jeudis soir chez les Viardot. Voilà un orgue qui sera écouté, et même joué, par l’élite culturelle du Paris de l’époque : Gounod, Berlioz, Flaubert, Delacroix, Scheffer (peintre ami de Louis Viardot), Flaubert, Saint-Saëns*, etc. Continuons à rapporter les mots de Pauline dans l’article de Musica cité ci-dessus : « [L’orgue] a vu de beaux concerts chez moi, surtout peut-être ceux qui étaient improvisés. Je me souviens d’un jour où Gounod voulut m’accompagner sur l’orgue l’air du Prophète [opéra de Meyerbeer], tandis que Saint-Saëns restait au piano … Jamais de toute ma vie je ne l’ai mieux chanté que ce jour-là : j’étais comme transportée. Le public aussi, je crois. Gounod lui-même chantait comme un ange, d’une voix frêle, mais avec une grâce infinie. Saint-Saëns chantait aussi… »
* Saint-Saëns l'écrit lui-même dans le portrait qu’il consacre à son amie dans L’école buissonnière (publié en 1913) :
« À l’orgue, comme au piano, j’avais l’honneur d’être son accompagnateur ordinaire ». Il avait une prédilection pour l'orgue et en particulier pour celui de Pauline. Saint-Saëns avait en effet obtenu le prix d’Orgue du Conservatoire en 1851, à l’âge de 16 ans.
Quant à Pauline, elle se souvient pour la revue Musica que Saint-Saëns "jouait tout d'ailleurs d'une façon étourdissante, soit au piano, soit à l'orgue".
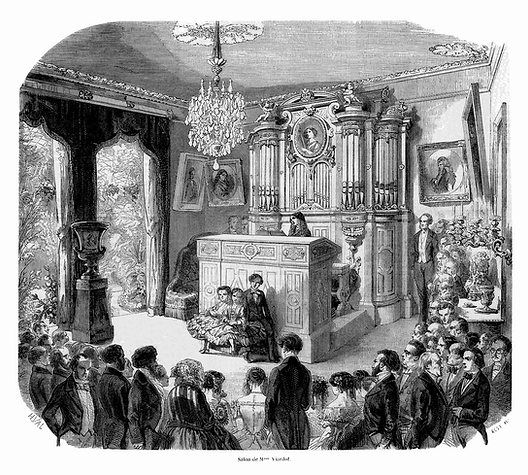%20R.png)
En mars 1853, L’illustration publie un article sur le « Salon de madame Viardot » avec une belle gravure le représentant. Au centre, la pièce maîtresse est l’orgue dont « Madame Viardot » joue, des enfants étant assis sur le devant.
La gravure souligne l’importance du groupe ainsi formé par sa distance à l’assistance et insiste sur le rôle de Pauline qui a coutume de s’accompagner lorsqu’elle chante, ou qui interprète des pièces pour orgue. Elle affectionne les œuvres de Bach, Gluck ou Mozart.
En haut du buffet, figure un médaillon avec un portrait de femme dont l’attribution a été discutée. On considère aujourd’hui qu’il s’agit du portait de sa sœur, La Malibran.
"Le salon de madame Viardot"
L’Illustration, volume XXI, no 525, du 19 mars 1853, page 183
H. Val, W. Best, graveurs. Source gallica.bnf.fr / BNF
Qui sont les enfants assis devant la console ? On peut lire sur Wikimedia Commons : « Près de l'orgue se trouvent les enfants de Mme Viardot et la fille du général russe Venediktov ». Or, en mars 1853, Pauline Viardot a effectivement déjà donné naissance à deux filles, Louise, qui a 11 ans, et Claudie, qui a 10 mois., ce qui ne correspond pas à la gravure. On s'interroge donc, soit sur la fidélité de la gravure, soit sur la véracité de la légende. Pauline aura deux autres enfants, Marianne née en mars 1854 et Paul, né en juillet 1857.
En avril 1863, Pauline Viardot, dont la voix décline, décide de faire ses adieux à l’opéra. Le mois suivant, le couple Viardot, qui souffre de l’opposition entre les positions républicaines de Louis et le régime monarchique de Napoléon III, s’exile avec ses enfants à Bade en Allemagne (aujourd’hui Baden-Baden).
Avant d’aborder le séjour à Bade, arrêtons-nous sur cet orgue de salon commandé par Pauline Viardot à A. Cavaillé-Coll.
La cantatrice Pauline Viardot
épreuve sur papier albuminé
Photo de 1860 par Pierre Petit
© Musée d'Orsay, Public domain,
via Wikimedia Commons

L’orgue de Pauline, une vitrine de l’excellence Cavaillé-Coll
%20R%20copie.png)
Aristide Cavaillé-Coll
Frontispice du livre écrit par ses enfants,
C. et E. Cavaillé-Coll (1929)
Source gallica.bnf.fr / BNF
Que connaît-on de l’orgue, installé par Aristide Cavaillé-Coll rue de Douai en 1851 ? Dans le mémoire détaillé établi par ce dernier le 26 mai 1851, on apprend que l’orgue comporte deux claviers de 54 notes associés à 14 jeux, un pédalier à l’allemande de 30 touches avec deux jeux de pédale indépendants (Bourdon 16 et Flûte 8), ainsi qu’une boîte expressive. Les tuyaux en alliage d’étain sont d’une grande qualité.
Pour le buffet, exécuté en chêne, Cavaillé-Coll n’a pas hésité à faire appel au sculpteur Michel (Joseph Napoléon) Liénard (1810-1870), créateur d’ornements réputé, qui a déjà collaboré à l'orgue de la cathédrale de Saint-Brieuc et travaille alors au buffet de l'orgue de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Liénard conçoit un important décor en bas-relief comportant de nombreux instruments de musique. Le buffet comme la console sont tous deux personnalisés par la présence des lettres 'V' (pour Viardot) et 'G' (pour Garcia) sculptées.
Le 'V'de Viardot sculpté sur le côté de la console de l'orgue, partie haute
Photo provenant de l'Inventaire des Orgues, Notre-Dame de Melun

En ce qui concerne la soufflerie, Cavaillé-Coll précise dans une lettre du 13 juillet 1855 : « Lorsque j’ai établi l’orgue de Madame Viardot, j’aurais voulu appliquer un moteur électrique* à la soufflerie, mais après avoir consulté l’habile ingénieur M. Froment, sur ses observations, j’ai dû renoncer à cette application. Le soin et la dépense qu’exige l’entretien d’une batterie électrique, sans compter les difficultés et les dépenses d’installation du premier appareil, de l’avis même du constructeur, nous avons dû renoncer à cette idée.
Jusqu’à présent le plus simple et le plus économique est de souffler au moyen d’une pédale, ou de faire souffler un enfant au moyen d’un levier… »
* Il s’agit du moteur électrique mis au point en 1844, puis perfectionné, par Gustave Froment. Il fonctionnait avec des électroaimants alimentés par un ensemble de piles en série qu’il fallait renouveler régulièrement. En effet, il n’existait pas encore d’accumulateur (ou pile rechargeable) en 1850/51, le premier accumulateur au plomb datant de 1859 (dû au Français Gaston Planté).
Les propos de Cavaillé-Coll illustrent à quel point ce dernier tenait à faire bénéficier ses orgues de toutes les évolutions techniques de son époque. Toujours en quête d’innovations, il fréquentait de nombreux savants, notamment le physicien Léon Foucault et l’ingénieur Gustave Froment, mais aussi Gaston Planté dont le frère Francis, pianiste, était un ami fidèle.
Toujours à l’affût des progrès, Cavaillé-Coll écrit, dans une autre lettre de 1859, qu’il avait envisagé d’adapter une machine hydraulique chez Madame Viardot, mais que « l’eau n’existait pas dans sa maison, ce qui a été un véritable obstacle. Je crois même qu’il sera difficile d’appliquer cette machine à Paris à cause de la pression de l’eau qui est très faible dans la majeure partie de notre cité. »
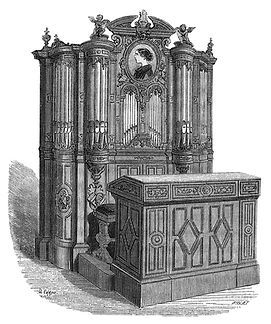
L’orgue de Pauline, qualifié « d’orgue exquis, chef-d'œuvre de Cavaillé-Coll » par Saint-Saëns, est la fierté de son constructeur au point d’être déménagé pendant six mois à l’exposition universelle de Paris à l’été 1855. Cet instrument dont il semble que, faute de place, n’aient été remontés que les jeux d’un seul clavier illustre, à petite échelle, le talent et les innovations du facteur d’orgue qui ne peut pas présenter sur place les quatre grands orgues d’église qu’il soumet également à l’appréciation du jury. C’est l’orgue de l’église Saint-Vincent-de-Paul qui lui rapportera la « Grande Médaille d’Honneur ».
Orgue de M. Cavaillé-Coll
dans Histoire illustrée de l'Exposition universelle, 1855, p. 114
© Édouard Diolot (1815-1884), graveur, Public domain, via Wikimedia Commons
La prédilection de Cavaillé-Coll pour l’orgue de Pauline Viardot est manifeste quand on constate que cet orgue figure encore sur le catalogue des productions de la firme daté de 1889, neuf ans avant la cession de l’entreprise à Charles Mutin.
L’orgue de Pauline déménage en Allemagne, puis revient rue de Douai. Ensuite ?
Rappelons qu’en mai 1863, les Viardot partent à Bade, ville d’eaux aristocrate et mondaine. L’orgue, transporté par Cavaillé-Coll, les rejoint en 1864. Il trouve sa place, ainsi qu’un piano à queue Pleyel, dans une petite salle de concert que les Viardot font construire au fond de leur propriété, la "Villa Viardot".
Fêtes et rendez-vous musicaux s’y succèdent, fréquentés par des personnalités telles que le roi Guillaume de Prusse ou le chancelier Bismarck, comme par des musiciens (Liszt, Saint-Saëns, Wagner, le pianiste Anton Rubinstein, Clara Schumann dorénavant veuve, etc.).

Vue générale de Baden-Baden en 1865
Collection De Vinck
Source gallica.bnf.fr / BNF

Une gravure parue en 1865 dans la revue allemande Der Bazar, représente "Ein Matinée in der Villa Viardot", c'est-à-dire un "salon" chez les Viardot.
Sur cette gravure, l’orgue est à l’arrière ; sa console est partiellement masquée par le piano. Contrairement à la gravure de l’Illustration, l’illustrateur a mis l’accent sur l’assemblée et sa distinction, prenant le soin d’indiquer le nom de certains participants illustres : Madame Viardot à l’orgue et Anton Rubinstein au piano, Ivan Tourgueniev, M. Viardot, … la duchesse d’Hamilton, la grande-duchesse Louise de Bade, Gustave Doré, …
"Ein Matinée in der Villa Viardot"
Der Bazar, Illustrierte Damen-Zeitung, n°46, 8 décembre 1865, p. 401
Source Université Heinrich Heine de Düsseldorf
La guerre de 1870 contraint les Viardot à quitter l’Allemagne. Après un court séjour à Londres, ils réemménagent rue de Douai en août 1871. L’orgue qui est resté à Bade est réinstallé à Paris en 1872. Les soirées musicales reprennent. L’auditoire comprend alors Lalo, Massenet, Fauré, Zola, Maupassant, etc. En revanche Berlioz et Delacroix sont décédés.
En 1874, Louis et Pauline acquièrent avec Tourgueniev une propriété à Bougival nommée aujourd’hui « Villa Viardot ». Ils auront plaisir à s'y rendre l'été et à y recevoir leurs amis.
Tourgeniev fait construire dans le jardin une datcha où il terminera ses jours en 1883. Dans l’article de la revue Musica de 1907, Pauline Viardot, âgée de 86 ans, mentionne, au sujet de l’orgue « Nous l’avons emporté avec nous à Bade, puis rapporté à Bougival… », sans préciser où était l’orgue de 1872 à 1874.

Villa Viardot à Bougival en 1971
© Moonik, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Cependant dans le chapitre de l’Inventaire des Orgues consacré à cet orgue, il est écrit qu’au départ de Bade : « L’orgue de Cavaillé-Coll suit avec les meubles et subit ainsi son... cinquième transfert ! On doute, cependant, qu’il fût remonté à Bougival. L’examen tout récent qui a été fait de cette maison, actuellement en cours de restauration, n’a permis d’y imaginer aucun emplacement possible pour un instrument de cette dimension. »
Un témoignage du facteur d’orgues Joseph Kœnig, employé de Cavaillé-Coll qui a entretenu l’orgue vers 1875, 1880 mentionne que ce fut à Paris : rue de Douai ?
En 1883, Pauline est anéantie par le décès de son mari et celui de Tourgueniev. L’année suivante, elle s’installe boulevard Saint-Germain à Paris et elle décide de se séparer de son orgue.
L’orgue est vendu par Pauline à la Collégiale Notre-Dame de Melun
Les Viardot possédaient, près de Vaudoy-en-Brie, le château de Courtavenel et l’ont occupé l’été, de 1844 à leur départ à Bade. Non loin de ce château se trouve le village de Chenoise dont le curé était à l’époque l’abbé Seroin. En 1884, cet abbé est devenu le curé de la collégiale Notre-Dame de Melun. Ce prêtre est à la recherche d’un orgue d’occasion pour sa nouvelle église, privée d’orgue depuis la Révolution. Il se tourne vers Pauline Viardot qu’il connaît depuis longtemps. Cette dernière lui propose d’acquérir son cher orgue.
Les négociations avec le conseil de fabrique ont lieu en 1884 et 1885. Une commission est chargée de contrôler l’état et la puissance de jeu de l’orgue. Elle constate que l’orgue « a été établi [par Cavaillé-Coll] dans des conditions exceptionnelles de solidité, et que, bien que négligé depuis quelque temps, son état matériel ne laisse rien à désirer… Les sons en sont moelleux… ». La puissance de jeu est estimée égale, sinon supérieure à celle de l’orgue de chœur de Saint-Sulpice. L’acquisition est donc décidée au prix de 7000 francs, Pauline conservant le médaillon représentant sa sœur, la Malibran.
Collégiale Notre-Dame de Melun (en 2005)
Située rue de la Courtille, sur l'île St-Étienne
© Tej commonwiki assumed CC-BY-SA 3.0

Courant 1885, l’orgue est installé dans l’église sur une tribune construite à cet effet. Il est inauguré le 21 septembre de la même année. Le 18 janvier 1886, Loison, organiste de l’école des aveugles, est nommé titulaire de cet instrument.
En août 1944, l’orgue souffre beaucoup lors de la Libération. Une explosion, qui a abîmé la rosace, a brisé l’arrière de l’orgue et tordu les tuyaux. L’impact d’un éclat d’obus reste visible sur la console.

Ruines sur l'île Saint-Étienne, après les bombardements de la seconde guerre mondiale
© Région Île-de-France (reproduction)
© Ville de Melun / Bibliothèque historique non classée
De multiples interventions sur la partie instrumentale ont été nécessaires après l’installation en 1885/86 jusqu'en 1966, année de l'inauguration par Marcel Dupré, tant en raison de la dégradation due à l’âge et au service, qu’aux dégâts occasionnés par les bombardements. On peut citer :
• Charles Mutin (1896 restauration)
• Nicolas (ou Narcisse ?) Duputel (1912 relevage)
• Paul-Marie Kœnig (1954 relevage et remise en état après les dommages de 1944)
• Jean Jonet (1966 modifications)
Le matériel d'origine (Cavaillé-Coll 1851) subsiste néanmoins en grande partie dans l'instrument. La tuyauterie est de très belle qualité avec des alliages riches en étain ; des modifications ont été cependant apportées par Jean Jonet.
%20R.jpg)
Orgue de Notre-Dame de Melun
(ancien orgue de Pauline Viardot)
Photo de 2020
© Daniel VILLAFRUELA, CC BY-SA-4.0
via Wikimedia Commons
La photo montre deux ailes latérales au buffet d’origine, un peu en retrait. Elles sont en sapin. On ne connaît pas la date de leur installation. L’emplacement du médaillon représentant la Malibran a été comblé par une horloge.
L’inauguration par Marcel Dupré
le 1er juin 1966
comporte le programme suivant :
Toccata et fugue en Ré m de J.-S. Bach,
Basse et Dessus de trompette de L.-N. Clérambault,
Sœur Monique de F. Couperin,
Final du Concerto pour orgue en Sol m de G.F. Haendel,
Pastorale de C. Franck
Deux œuvres de Marcel Dupré.

Orgue de Notre-Dame de Melun
(ancien orgue de Pauline Viardot)
Vue latérale
© Stéphane Asseline, Région Île-de-France

Orgue de Notre-Dame de Melun
(ancien orgue de Pauline Viardot)
Console
© Olivier Salandini

Orgue de Notre-Dame de Melun
(ancien orgue de Pauline Viardot)
Partie centrale
© Stéphane Asseline, Région Île-de-France
Depuis la restauration de Jean-Claude Alcouffe en 1983, l’orgue attend une nouvelle restauration complète. Sur ce sujet, on peut consulter le document ci-dessous du 3 octobre 2024 sur France-Musique (durée : 6 min), où s’expriment Jean-Michel Franchet, président de l’Association Les Amis de l’orgue de Melun, Dominique Ghesquière, conservatrice des musées de Melun et le père Philippe Legrand, curé de la paroisse :
Qu’aurait dit Pauline Viardot, en apprenant que le projet de restauration de son cher orgue au XXIe s. conduirait
un prêtre à envisager de sauter en parachute
pour inciter aux dons et compléter le budget requis à la réparation ?
Décidément, l’orgue de Pauline Viardot n’aura jamais connu la banalité !

Photographie de Pauline Viardot
entre 1880 et 1905
par Wilhelm Benque
Source gallica.bnf.fr / BNF
Sources :
• Patrick Barbier, Pauline Viardot, Biographie, Paris, Édns Grasset et Fasquelle, 2009.
• Une famille de grands musiciens, Mémoires de Louise Héritte-Viardot, recueillies par Louis Héritte de la Tour, 3e édn, Stock, Paris, 1923.
• Camille Saint-Saëns, L’École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, p. 220.
• « Salon de madame Viardot » dans L’illustration, vol. xxi, no 525, 19 mars 1853, pp. 183-184.
• Pauline Viardot, « La jeunesse de Saint-Saëns », Revue Musica, juin 1907, pp. 83-84
https://agorha.inha.fr/ark:/54721/bb6595ca-3ef3-4aaa-86b9-af71fc690463
• Cécile et Emmanuel Cavaillé-Coll. Aristide Cavaillé-Coll. Ses origines. Sa vie. Ses œuvres, Paris, Fischbacher, 1929.
• Fenner Douglas : Cavaillé-Coll and the Musicians, vol. 2, Sunbury Press, U.S.A., 1980, Lettre du 13 juillet 1855 (p. 947).
• Fenner Douglas : Op. Cit. Lettre du 23 mars 1859 (p. 1050).
• « Orgue de M. Cavaillé-Coll » dans Histoire illustrée de l'Exposition universelle, par catégories d'industries, avec notices sur les exposants, Charles Robin, Furne, Paris, 1855, page 114.
• « Eine Matinée in der Villa Viardot », dans Der Bazar, Illustrierte Damen-Zeitung, no 46, 11e année, 8 décembre 1865, pp. 400-402, lire en ligne (de) sur le site de la bibliothèque numérique de l'Université Heinrich-Heine de Düsseldorf (HHU).
• Inventaire des Orgues : https://inventaire-des-orgues.fr/media/77/FR-77288-MELUN-NDAMEV1-X/fichiers/FR-77288-MELUN-NDAMEV1-X.pdf
• France Musique : Le fabuleux destin de Pauline Viardot (Charlotte Landru-Chandès)
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-fabuleux-destin-de-pauline-viardot
1. 11 juillet 2021 : Le Clan Garcia
2. 18 juillet 2021 : La sœur de la Malibran
3. 25 juillet 2021 : George Sand et Frédéric Chopin
4. 1er août 2021 : Le temps des voyages
5. 8 août 2021 : La muse des compositeurs, De Gounod à Berlioz
6. 15 août 2021 : Le salon des Viardot, au cœur des cercles artistiques
7. 22 août 2021 : L’heureux exil à Bade, entre vie de famille et mondanités
8. 29 août 2021 : Pauline Viardot et Ivan Tourgéniev
Pour écouter certaines compositions de Pauline Viardot, de sa fille Louise et de son fils Paul, de son père Manuel Garcia et de sa sœur, Maria Malibran, écouter l'émission Allegretto du 22 mai 2025 sur France Musique, "Chez les Viardot" :
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/allegretto/allegretto-du-jeudi-22-mai-2025-9866160
JOUER POUR DÉGUSTER
DE L'ORGUE À SAVEURS AU PIANOCKTAIL
L'orgue à saveurs
Sans doute avez-vous entendu parler du « clavecin oculaire », du Père jésuite Louis-Bertrand Castel ? Cet instrument, imaginé pour « rendre visibles les sons », a été conçu pour que chaque touche du clavier dévoile une étoffe de couleur donnée. Castel entendait ainsi composer la « Musique des couleurs ».
Même si aucune certitude n’existe quant à l’achèvement, toujours repoussé, de ce clavecin perfectionné, l’instrument a fait couler beaucoup d’encre pendant plusieurs décennies, et n’a pas échappé aux moqueries, comme en témoigne cette caricature (en couleurs) du dessinateur Charles-Germain de Saint-Aubin (1721 - 1786).
Caricature du clavecin oculaire du Père Castel
Charles-Germain de Saint-Aubin
Source : Waddesdon, The Rothschild Collection (The National Trust)
Public domain, via Wikimedia Commons

Le Père Castel, qui a émis l’idée de son invention en 1725 dans le Mercure de France, a publié l’année suivante, dans la même revue, une série de commentaires baptisés « Difficultez », sous forme de questions-réponses. Il y suggère, en particulier, la conception de nouveaux claviers destinés à rendre les sons perceptibles par les autres sens que l'ouïe et la vue, et notamment le goût.

En 1755, le Père Polycarpe Poncelet, abbé des Récollets et agronome, s’empare de la suggestion du Père Castel et développe son projet dans la dissertation préliminaire de son ouvrage « Chimie du goût et de l'odorat, ou Principes pour composer aisément, & à peu de frais, les liqueurs à boire, & les eaux de senteurs » (publié anonymement).
En revanche, le contenu du livre qui porte sur l'élaboration par distillation des eaux de vie, et sur celle de diverses infusions et préparations, savoureuses comme odorantes, à partir de fruits et de baies, ne fait plus état de ce projet.
Ouvrage publié anonymement en 1755,
écrit en totalité par l'abbé Poncelet
Par sa dissertation préliminaire, l’abbé Poncelet se rallie aux idées qui ont cours au Siècle des Lumières sur l’harmonie des sensations, ainsi que sur l’aspect artistique dont la cuisine "moderne" commence à relever. L’abbé ne pouvait en effet ignorer l’ouvrage « La Science du Maître d’hôtel cuisinier » paru en 1749, dont la dissertation préliminaire prône « l’harmonie des saveurs », établissant une relation synesthésique entre le goût et la musique (voir le texte de Foncemagne).

Ouvrage publié
anonymement en 1749,
écrit (sauf la dissertation préliminaire) par Joseph Menon

La dissertation préliminaire
(non signée)
est de l'académicien
Étienne Lauréault
de Foncemagne.
Ce dernier écrit page vi :« Sera-t-on donc blâmé d'avancer qu'il y a l’harmonie des saveurs, comme l’harmonie des sons, et peut-être celle des couleurs et des odeurs ? […] J’avance qu’il règne entre les saveurs une certaine proportion harmonique, à peu près semblable à celle que l’oreille perçoit dans les sons, quoique d’une espèce différente »
C'est bien dans le même ordre d’idées, que l'abbé Poncelet écrit dans sa propre Dissertation préliminaire :
« il peut y avoir une musique pour la langue et pour le palais, comme il y en une pour les oreilles ».
Selon l’abbé, contrairement au clavecin des couleurs qui n’a pas abouti, « il est possible de faire un instrument harmonieux des saveurs, […] comme un nouveau genre d’orgue, sur lequel on pourra jouer toutes sortes d’airs savoureux, pourvu que le nouvel organiste possède avec intelligence son clavier ». En effet, conformément à la gamme des saveurs qu’il propose, chaque touche du clavier engendrerait la perception d’une « saveur primitive, base de la musique savoureuse ». Cette dernière doit également obéir aux règles de composition qu’il préconise pour obtenir de belles consonances, musicales comme gustatives.

Gamme des saveurs de l'abbé Poncelet
p. xx de la Dissertation préliminaire de
Chimie du Goût et de l'Odorat .... (1755)
L’abbé Poncelet met son projet à exécution et construit l’orgue à saveurs. L’instrument est décrit en détail dans la dissertation préliminaire de la nouvelle édition totalement refondue de son ouvrage, parue en 1774. Cet orgue mixte comporte un seul clavier, deux soufflets manœuvrés au pied, une rangée de tuyaux et un nombre égal de fioles placées en regard, contenant les liqueurs aux saveurs primitives. En pressant une touche du clavier, on déclenche l’ouverture simultanée des soupapes d’un tuyau de l'orgue et de la fiole correspondante, tous deux associés à la note jouée. Ainsi se produisent ensemble l’émission de sons et la distribution de liqueurs recueillies dans « un grand gobelet de cristal ».
Poncelet note que si le rendu sonore est discordant, on ne trouve « dans le réservoir commun qu’une liqueur détestable. Au contraire, si l’on touche le clavier savamment, de manière à former des combinaisons de tons harmoniques, la liqueur qui se trouve dans le réservoir est admirable ».
Il pense ainsi avoir démontré « qu’il y a véritablement une musique pour la bouche comme il y en a une pour les oreilles, et que les principes de ces deux musiques sont absolument les mêmes ».
Les saveurs de l'orgue
_edited.jpg)
Karl-Joseph Riepp (1710 - 1775)
Portrait peint par Andreas Brugger
en 1774 à Salem
© Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Dijon
Né en Allemagne en 1710, installé à Dijon en 1743, marchand de vins et propriétaire de vignobles, K.-J. Riepp, naturalisé français en 1747, était bourguignon d’adoption. Connu pour les orgues qu’il a construits en France (Besançon, Dijon, Dole, Beaune, …), il a aussi exercé dans sa région d’origine, la Souabe, en particulier à l’abbaye de Salem où, à la demande de l’abbé Anselm II, il a édifié trois orgues (entre 1766 et 1774). C’est donc là qu’il a écrit le curieux document nommé ci-dessus, en allemand, à l’occasion du carnaval qui, se déroulant de l’Épiphanie à Mardi-gras, est le moment de faire bonne chère avant le jeûne du Carême.
Pour rendre l’orgue compréhensible à tous, K.-J. Riepp fait correspondre à chacun des éléments de cet instrument, un composant de la cuisine et, aux jeux, des plats cuisinés. Voyez les exemples ci-dessous.
Associer, non pas les touches du clavier, mais les jeux de l’orgue à des saveurs, et même aux saveurs complexes de mets élaborés : voilà la trouvaille inattendue que nous réserve le célèbre facteur d’orgues Karl-Joseph Riepp, dans un texte écrit en 1768, à l’abbaye de Salem, intitulé : « Le facteur d’orgue et quisinier pour Carnevalle fasnacht * » et dont le manuscrit est dorénavant conservé à Karlsruhe.
* « Fastnacht » désigne le carnaval souabe et alémanique.


%20Mus%C3%A9e%20du%20prado%20R.jpg)
Nature morte aux deux perdrix
Luis Eugenio Meléndez
peinte entre 1769 et 1800
© Musée du Prado, Madrid
Domaine public

Nature morte
aux légumes et au gibier
Anonyme vers 1740
© Lyon MBA, Photo Louis Houdus
Domaine public

Des registrations sont données sous forme de menus destinés à diverses catégories de personnes (officier, guerrier, facteur d’orgues, amateur ou connaisseur, vieillard, prélat…). Des exemples sont joints ci-dessous. Ainsi présenté, l’art de la combinaison des jeux est sensé être moins ésotérique pour le profane.

K.-J. Riepp ne manque pas d'adresser un clin d'œil à ses lecteurs dans sa conclusion :
"Ces aliments peuvent aussi être consommés pendant le jeûne, ou même avant un repas, car les facteurs d’orgues ne sont que de piètres cuisiniers."
Que penser de l'emploi par K.-J. Riepp d'une telle métaphore culinaire ? Le sachant assez cultivé, et le devinant bon vivant, on peut penser qu’il connaissait les ouvrages cités dans la partie précédente qui traitent de gastronomie, tout en rapprochant harmonies gustatives et harmonies musicales.
Peut-être, K.-J. Riepp a-t-il voulu, certes témoigner de sa fantaisie et de son humour, mais aussi s’inscrire dans les courants de pensée de son époque, le facteur d’orgues étant, tel le cuisinier, un « compositeur des saveurs » ?
L'orgue à bouche et le pianocktail
Dans son roman À Rebours, publié en 1884, Joris-Karl Huysmans met en scène le personnage décadent du duc Jean Floressas des Esseintes. Cet aristocrate névrosé souhaite s’isoler du monde extérieur et de la société qu’il déteste. Triste et malade, il s’évade de la réalité par l’ivresse. Pour jouir de toutes les saveurs que les boissons alcoolisées peuvent lui procurer, il utilise « l’orgue à bouche », instrument destiné à créer des polyphonies gustatives.

Joris-Karl Huysmans et son chat
Portrait par Eugène Delâtre inclus dans le manuscrit de À Rebours (1884)
© BNF-Bibliothèque de l'Arsenal
Il s’agit d’un assemblage de barils à liqueurs et de pistons, manœuvré par des boutons pour délivrer les alcools souhaités. Si, dans l’imagination de l’auteur, l’aspect de la machine apparente cette dernière à un orgue, il s’agit néanmoins d’un orgue muet. Chaque liqueur évoquant dans la bouche de des Esseintes le son et le volume sonore d’un instrument, la musique ne résulte que d’une expérience synesthésique :« il était parvenu, grâce à d’érudites expériences, à se jouer sur la langue de silencieuses mélodies, de muettes marches funèbres à grand spectacle, à entendre, dans sa bouche, des solis de menthe, des duos de vespétro et de rhum. »
Notons que le fonctionnement de l’orgue à bouche évoque en tout point l’orgue à saveurs de l’abbé Poncelet, dont il est admis que J.-K. Huysmans s’est inspiré, même si l’orgue de l’abbé permettait, lui, de jouer de la musique.
Un point commun, néanmoins :
il n’a été publié, à notre connaissance, aucune représentation iconographique de chacun de ces orgues.
À nous de les imaginer …

Des Esseintes
imaginé par Odilon Redon (1888)
ami de J.-K. Huysmans
Lithographie
Source : gallica.bnf.fr/BNF
Dans l’Écume des jours (paru en 1947), Boris Vian conte la destinée de Colin et de Chloé, la femme qu’il aime, qui tombera malade et mourra. La musique, en particulier de jazz, est constamment associée à l’amour dans ce roman.
Au début, Colin, qui vit dans une atmosphère rayonnante, construit un pianocktail, instrument alliant en quelque sorte le piano et l’orgue à bouche (alors actionné par les touches), et permettant la constitution de cocktails dont la composition dépend du morceau joué.
À son ami Chick, Colin explique :« À chaque note, … je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l’œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l’eau de Selbtz [sic], il faut un trille dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée : à la quadruple croche équivaut le seizième d’unité, à la noire l’unité, à la ronde le quadruple unité… Il n’y a qu’une chose gênante, dit Colin, c’est la pédale forte pour l’œuf battu. J’ai dû mettre un système d’enclenchement spécial, parce que lorsqu’on joue un morceau trop « hot », il tombe des morceaux d’omelettes dans le cocktail, et c’est dur à avaler. Je modifierai ça. »
• Cet instrument ludique a été construit dans les années 2010 par Voel Martin et Aurélie Richer, et une démonstration en a été donnée sur France 2 dans l’émission La Boîte à Musique de Jean-François Zygel en 2011 (où il est appelé piano-cocktail) : Cliquer pour Regarder et déguster.
• Un autre pianocktail a été réalisé plus récemment par Cyril Adam et Cédric Moreau ; on peut l’écouter et le voir en cliquant sur : Regarder et déguster

Boris Vian en 1948
Féru de jazz, et trompettiste
Studio Harcourt

Édition originale, 1947
Sources et crédits :
• R. P. Castel, Clavecin pour les yeux, avec l’art de Peindre les sons et toutes sortes de Pièces de Musique, Mercure de France, 1er nov. 1725, pp. 2552-2577
• R. P. Castel, Difficultez sur le clavecin oculaire, avec leurs réponses, Mercure de France, 1er mars 1726, pp. 455-461
• [Polycarpe Poncelet] Chimie du goût et de l'odorat, ou Principes pour composer aisément, & à peu de frais, les liqueurs à boire, & les eaux de senteurs, Paris, Imprimerie P. G. Le Mercier, 1755
• [Joseph Menon] La Science du Maître d’hôtel cuisinier, Paris, Paulus-du-Mesnil, Imprimeur-Libraire, 1749. La Dissertation préliminaire sur la Cuisine moderne, non signée, est d’Étienne Lauréault de Foncemagne.
• [Polycarpe Poncelet] Nouvelle Chymie du goût et de l’odorat, ou l’Art de composer facilement, & à peu de frais, les liqueurs à boire, & les eaux de senteurs, Nouvelle édition, Paris, Pissot, Libraire,1774 (2 tomes en un volume)
• P. M. Guéritey, Karl Joseph Riepp et l'orgue de Dole, Imprimerie Férréol, Lyon, 1985 (2 tomes)
• Tables de registration pour la musique d'orgue française du XVIe au XIXe siècle, Compilation de Roland Lopes, 2007-2012
• Orgue et gastronomie : L'art d'accommoder les jeux, Dr Jean Vitaux, Canal Académies, 15 juin 2008,
• Borgne (16 décembre 2022). La symphonie des goûts de des Esseintes : l’orgue à bouche de Huysmans. Master Littérature, Savoirs et Culture numérique. https://doi.org/10.58079/r37s
• Dans les exemples de menus : couronne royale allemande : CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia Commons ; grappe de raisin : Etiennekd, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons ; Figurine du musicien ambulant, attribuée à J. J. Kändler, produite entre 1735 et 1756, Manufacture de Meissen, © Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
SIFFLER EST-CE JOUER ?
LE CALLIOPE OU L'ORGUE À VAPEUR
Vers la moitié du XIXe siècle, une idée surgit. Pourquoi ne pas injecter de la vapeur d’eau dans une série de tubes métalliques pour obtenir des sons ? Le trompettiste, le tromboniste et bien d’autres musiciens insufflent bien un air chaud et humide dans leurs instruments. Ainsi naîtrait un orgue à vapeur.
À cette époque de révolution industrielle, l’énergie fournie par la vapeur est reine et l’Amérique est particulièrement novatrice dans ce domaine. C’est là que l’orgue à vapeur voit le jour. Le Monde illustré du 28 janvier 1860, dans son article consacré à l’invention de cet instrument, n’écrit-il pas :
« L'Amérique est le pays par excellence de l'excentricité. Depuis l'invention de la vapeur, c'est de là que nous sont venus les récits les plus merveilleux sur le téméraire emploi de ce moteur ».

Trompettiste et joueuse d'orgue hydraulique
Musée du Louvre
1er s. av. J.-C. - 1er s. ap. J.-C. -
© Romainbehar, CC0, via Wikimedia Commons
_edited.jpg)
On évoque plusieurs inventeurs, mais c’est Joshua C. Stoddard (1814 – 1902) de Worcester (Massachusetts) qui dépose un brevet, le 9 octobre 1855, pour un instrument constitué de quinze sifflets susceptibles de fonctionner à la vapeur ou à l’air comprimé. L’appareil est actionné par un rouleau muni d’une manivelle, à la manière des boîtes à musique ; Stoddard complète rapidement ce dispositif par un clavier, pour jouer de cet instrument à la manière d’un orgue. Il l’appelle "piano à vapeur".
Photographie de J. C. Stoddard
avec son calliope à vapeur
© Museum of Worcester (MA, USA)
De par sa conception, cet orgue à vapeur émet des sons aigus (tuyaux courts), forts et stridents (arrivée soudaine de la vapeur sous forte pression) et … pas toujours justes (influence de la température de la vapeur sur les notes jouées par les sifflets). On l’entend à plusieurs kilomètres à la ronde. Le volume du son est néanmoins un atout car il permet de surpasser le bruit de la vapeur qui s’échappe des sifflets. En effet, le fonctionnement à la vapeur est alors privilégié par rapport à l’air comprimé, car plus facile à mettre en œuvre. Est-ce ironiquement que cet instrument a été baptisé du doux nom de la mère d’Orphée, Calliope (littéralement belle voix), muse de la poésie et de l’éloquence ? Ou est-ce parce qu’on représente d’ordinaire cette muse soufflant dans une trompe ?

Calliope, mère d'Orphée,
muse de la poésie et de l'éloquence
Parchemin, XVIe s.
Source.gallica.bnf.fr/BNF

Par la suite, Arthur S. Denny, un employé de l’entreprise de Stoddard, améliore le calliope : « l’organiste » peut moduler l’intensité du son en agissant sur la pression de vapeur admise. Cherchant à vendre l’instrument en Europe, Denny le présente dans le Crystal Palace à Londres en novembre 1859, ce qui fait connaître l’orgue à vapeur sur ce continent, sans néanmoins obtenir le succès commercial escompté.
Le calliope, ou orgue à vapeur
Exposé au Crystal Palace (Londres) en novembre 1859 par A. S. Denny qui l'a modifié pour pouvoir moduler le volume sonore. Le bouilleur est sous le plancher.
© The illustrated London News, 3 déc. 1859, p. 11
Alors que Stoddard prédestine le calliope au remplacement des cloches dans les églises en raison de la puissance du son, c’est surtout sur les bateaux à vapeur, dans les foires et dans les cirques que l’instrument devient populaire. L'affiche ci-dessous en témoigne.
Légende du bas de l'affiche :
Calliope! The wonderful Operonicon or Steam Car of the Muses, as it appears in the gorgeous street pagent [sic] of the Great European Zoological Association !
British Museum, Royal Coliseum, Gallery of Art, World's Congress and Gigantic Circus! 12 tents! 900 men and horses! One ticket admits to all !.
Traduction de la légende :
Calliope ! Le merveilleux Opéronicon ou la Voiture à Vapeur des Muses, tel qu'il apparaît dans le magnifique spectacle de rue [sic] de la Grande Association Zoologique Européenne ! British Museum, Royal Coliseum, Gallery of Art, Congrès Mondial et Gigantic Circus ! 12 tentes ! 900 hommes et chevaux ! Un seul ticket pour l'ensemble !.
Affiche conservée par la bibliothèque du Congrès des USA, Washington
1874, chromolithographie 55 x 71 cm
© Gibson & Co, Public domain, via Wikimedia Commons
La plupart des calliopes à vapeur disparaissent au cours du XXe siècle quand, d’autres sources d’énergie s’imposant, le savoir-faire nécessaire au fonctionnement des chaudières à vapeur tend à disparaître. En outre, dès le début du XXe s., les calliopes fonctionnant à l’air comprimé et souvent grâce à des rouleaux, détrônent les calliopes à vapeur. Appelés calliaphones, ils sont à la fois plus sûrs et plus justes. Une entreprise américaine continue à en construire de nos jours.

Un calliaphone de la marque Tangley, datant d'environ 1920, équipe cette
Ford Model T (1915-1916) la transformant en "Music Truck" (camionnette musicale)
Technical museum of Vadim Zadorozhny, Arkhangelsk, Russie
© Stanislav Kozlovskiy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Néanmoins, la charmante originalité et le pittoresque des calliopes à vapeur, ainsi que leur étonnante histoire, font que certains sont encore employés pour divertir, lors de diverses manifestations et sur des bateaux de tourisme naviguant, notamment, sur le Mississippi. Là également, une entreprise américaine en activité aujourd'hui a conservé le savoir-faire de leur fabrication.

Calliope à vapeur du Western Development Museum
(Saskatchewan, Canada)
Construit en 1955 par L.K. Wood (Mendon, Utah), il possède 32 sifflets en laiton. Acheté par le musée en 1959, il a été monté, ainsi que son bouilleur (contenant presque 6 m3 d'eau), sur le chassis d'un ancien véhicule de pompiers. Restauré en 1976, puis 2001, il a été une des attractions du pavillon du Canada lors de l'exposition de Vancouver en 1986. Il a circulé au sein du Saskatchewan pour animer diverses manifestations jusque vers la fin des années 2010. La corniste Arlene Shiplett, en était l'organiste attitrée.
© Western Development Museum, Saskatchewan, Canada
Calliope à vapeur du bateau Le Natchez (Nouvelle-Orléans)
Le bateau à aube, propulsé par un moteur à vapeur, Le Natchez propose des croisières touristiques sur le Mississippi à partir de la Nouvelle-Orléans. À chaque voyage, le calliope situé sur son toit (entouré d'un ovale rouge sur la photo) donne un petit concert avant le départ.


Pour écouter le calliope du Natchez, cliquez ici.

Le Natchez, bateau à vapeur et à aube, possède sur son toit un calliope à vapeur
© The New Orleans Steamboat Company
UnE ŒUVRE D'ART : LE calliope à vapeur
« La Vase et le Sel » de Bettina Samson
(Bègles près de Bordeaux)
Cet orgue à vapeur, inauguré en 2019, a été conçu par l'artiste Bettina Samson à la suite d’une commande de Bordeaux Métropole. Il est situé à Bègles, sur le chemin de halage longeant les rives de la Garonne et bordant un centre de traitement des déchets qui l’alimente en vapeur sous haute pression. Ses 38 sifflets, faits d’un alliage de cuivre, sont commandés par un automatisme réalisé avec des technologies numériques. Après la résolution de nombreuses difficultés techniques inhérentes au projet, l’orgue est fonctionnel depuis avril 2021.
L’œuvre relie l’usine au fleuve, et Bordeaux à son passé. L’installation "La Vase et le Sel" a, en effet, pour vocation de faire émerger l’histoire marquée par la Traite Atlantique et l’esclavage, lorsque « l’île à sucre » de Saint-Domingue (futur Haïti) était spécifiquement reliée à Bordeaux, port négrier et principal port colonial français au XVIIIe siècle.
C’est pourquoi l’orgue émet, tour à tour, des incantations, un Jazz Funeral presque dansé, les rythmes vifs de chansons paysannes haïtiennes, des polyphonies de flûtes ou des rythmiques électroniques (arrangements musicaux de Cédric Jeanneaud).

Ainsi, cet instrument rend hommage aux « voix » rassemblées lors de la cérémonie du Bois-Caïman (nuit du 15-08-1791) qui signe le début de la révolution menée par les esclaves et pour l’indépendance d’Haïti (1804). L’orgue est déclenché, du mercredi au dimanche, à 15h08, horaire destiné à rappeler la date de cette cérémonie.

Œuvre La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope),
Bettina Samson
© J.-B. Menges, Bordeaux Métropole
Le Port de Bordeaux vu du quai des Farines, 1776
© Nicolas-Marie Ozanne, Public domain, via Wikimedia Commons
À noter que l’originalité sonore de l’instrument a stimulé la créativité du compositeur et percussionniste Xavier Roumagnac. Après avoir collaboré avec Bettina Samson en 2023 pour doter le répertoire de l’orgue d’un Groove créole qu’il a composé, X. Roumagnac a poursuivi en composant huit nouveaux morceaux rythmiques, présentés au public lors des journées du patrimoine 2024. Il s’agit d’un travail de composition atypique pouvant s’adapter aux spécificités sonores de l’instrument, ainsi qu'à sa justesse aléatoire et sa dépendance aux conditions météorologiques.
Les personnes intéressées par la singularité d’un tel travail de composition peuvent se rendre sur le site internet de Xavier Roumagnac.
Pour aller plus loin :
• consulter le livret : "La vase et le Sel"
• écouter sur France Musique (27 janvier 2023, 3 min) : "La vase et le sel", un orgue à vapeur sur les bords de la Garonne
SOUFFLER N'EST PAS JOUER... VRAIMENT ?

Sans « vent », l’orgue est un corps sans âme. Ainsi s’exprime l’auteur de l’article relatif aux soufflets de l’orgue, dans l’Encyclopédie en 1765 [1]. En effet, la musique de l’orgue est produite par la vibration de l'air pulsé dans les tuyaux, eux-mêmes mis en vibration.
À partir des années 1920, les ventilateurs électriques ont remplacé les souffleurs qui actionnaient les soufflets, ou se sont substitués à des dispositifs intermédiaires ayant suppléé les souffleurs dès la fin du XIXe siècle. Seuls certains petits orgues positifs ont conservé aujourd'hui une pompe qui alimente le soufflet, pompe actionnée par une pédale.
Les ventilateurs alimentent la soufflerie, élément de l'orgue rarement détaillé dans la description d'un l'instrument aujourd'hui. Pourtant, comme le mentionne Friedrich Jakob [2] « aux XVIIIe et XIXe siècles, on mentionnait souvent le nombre et la grandeur des soufflets en plus des divers jeux de l’instrument » dans la présentation d’un orgue.

Les "vents" sont extraits d'une gravure sur bois d'Albrecht Dürer, MET, (New-York), non datée

Mais parlait-on des indispensables souffleurs ? Quels souvenirs a-t-on d'eux à part quelques anecdotes ? Ces personnes, sans lesquelles l’orgue était muet, n’ont été en effet que peu évoquées, et que peu représentées, surtout après la Renaissance ; leur absence de qualification, leur labeur physique, répétitif et souvent exténuant, ne méritait sans doute pas de souligner leur rôle essentiel.
C’est pourquoi nous leur destinons ce clin d’œil, à la faveur d’images diverses et de textes
se rapportant aux divers types d'orgues.
ORGUE HYDRAULIQUE
Orgue hydraulique
Psautier d'Utrecht
(820-835)
Dessin à la plume, fol. 83

Image extraite du document numérisé par l'Université d'Utrecht
(le trait noir figurait sur l'image source)
https://psalter.library.uu.nl/page/173
ORGUE PORTATIF
Instrument posé sur le genou, ou maintenu le long du corps grâce à un baudrier.
_edited.jpg)
Sainte Cécile joue de l'orgue
Extrait de la partie gauche du
Retable de la Sainte Croix (1490-1495)
du Maître de la St Barthélémy
Wallraf-Richartz-Museum, Cologne
La main qui tient l'ageau
est celle du personnage voisin.
Un seul soufflet : l'organiste est aussi souffleur
L'organiste porte l'orgue ; il joue de la main droite et actionne le soufflet avec sa main gauche. L’orgue reste silencieux pendant que le soufflet aspire l’air.

Ange jouant de l'orgue portatif
(1400-1500), sculpture en calcaire
© Musée des Augustins, Toulouse

Jeune femme dans un paysage jouant de l'orgue portatif
Maître des anciens Pays-Bas (vers 1420)
© RMN-Grand Palais, Louvre/Thierry Le Mage
ORGUE POSITIF DE TABLE
Instrument "posé" sur une table. L'organiste et le souffleur sont placés de part et d'autre, assis ou debout.

Deux soufflets
L'organiste a besoin d'un(e) souffleur(euse) qui actionne alternativement
et régulièrement les soufflets.
Ainsi, aucune interruption de la ligne musicale.
Il existait diverses sortes de soufflets qu'on utilisait avec les mains ou les pieds.
Le joueur d'orgue et sa femme
Gravure de Israhel von Meckenem (1495-1500)
© Cleveland Museum of Art

Tapisserie de la Dame à la licorne : L'Ouïe
Musée de Cluny, vers 1490
© Thesupermat, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ORGUE POSITIF
Instrument plus volumineux que les précédents, avec un plus grand nombre de tuyaux. Il est donc "posé" sur le sol.
Le Roi David entouré de musiciens
Enluminure représentant un orgue positif
avec le souffleur au premier plan
Psautier d'Élisabeth de Hongrie (1201-1208)
© Musée arch. de Frioul (Italie)

Organiste
Orgue positif
Image d'un psautier du XIVe s.
reproduction de N.-X. Willemin (1806)
dans Monuments français (1839)
© Gallica/BNF

_edited.png)
L'orgue accompagne le chant des élus qui pénètrent au paradis lors du Jugement dernier.
L'organiste et son souffleur sont des enfants.
Orgue positif
Enluminure médiévale (XVe s.)

Commentaires de André Pottier, auteur de l'ouvrage :« Notre orgue est garni de trente-quatre tuyaux, disposés sur deux rangs, et d’un gros tuyau isolé, qui sans doute fournissait, comme le bourdon de la vielle, un accompagnement de basse continue. L’organiste, en costume de clerc, est assis devant son clavier, que la position de l’instrument nous empêche de voir, et un frère servant, agenouillé à l’opposé, fait mouvoir alternativement les deux soufflets qui fournissent l’air au sommier de l’instrument. »
Sculpture du portail de la Dame Blanche
Cathédrale de León (Espagne)
(fin du XIIIe s.)

Orgue médiéval à douze soufflets, faits avec la peau de deux éléphants
Martin Gerbert,
De Cantu et Musica Sacra...
Sankt Blasien, 1774, T.II, p. 137
L'agrandissement des orgues positifs
s'est accompagné d'une multiplication des soufflets, et de la nécessité de faire appel à plusieurs souffleurs
Les soufflets de cet orgue (apparemment douze) s'assemblent en deux "conflatoria*", et deux porte-vent conduisent l'air aux sommiers.
L'organiste actionne des tirettes qui sont les ancêtres des touches du clavier.
* réservoirs que remplissent les soufflets

Miniature de la Bible d'É. Harding
(Cîteaux, 1109-1112, ms 14, fol. 13)
ORGUE DE GRANDE TAILLE
En 951, un orgue est consacré dans l'église Saint-Pierre de Winchester (dans le sud de l'Angleterre). Dotted Crotchet, dans un article publié en 1901 [3], évoque ainsi la description de cet orgue par un moine dans un poème écrit en latin :
"[Les 26 soufflets], par souffles alternés, fournissent une immense quantité de vent, et sont actionnés par soixante-dix hommes forts, travaillant de leurs bras couverts de sueur, chacun incitant ses compagnons à pousser le vent de toutes ses forces, pour que le sommier puisse parler avec ses quatre cents tuyaux que gouverne la main de l'organiste."

Orgue de Saint-Martin d'Halberstadt (1361)
décrit par M. Praetorius,
De Organographia, 1619
Soufflets actionnés au pied

Schéma de l'orgue français du XVIIIe s.
Dom Bédos de Celles, L'art du facteur d'orgues (1766) pl. LII
Soufflets cunéiformes actionnés à la main à l'aide de leviers
Les orgues comportaient un dispositif de communication entre l'organiste et le(s) souffleur(s). C'est "la sonnette pour le souffleur", qui est une clochette commandée par un des registres de l'orgue afin d'indiquer au(x) souffleur(s) le moment de mettre en route les pompes, l'organiste devant intervenir incessamment.

Les souffleurs de Notre-Dame (Paris)
L'illustration (1894)
Les souffleurs actionnent
les pompes à pied des soufflets mécaniques

"Marcel Dupré raconte..."
Bornemann, 1972, p.86
Comment Notre-Dame fut
dotée d'une soufflerie électrique
Dans ce texte, "Johnson" est Claude Johnson, alors PDG de la firme Rolls-Royce
Ce qui est relaté date de 1919.
Pour compléter ce clin d'œil, écouter sur France Musique : La petite histoire des souffleurs d'orgue (durée 2 min).
Références
[1] L’Encyclopédie, vol XV, 1765, P. 395 b – 397 b
Académie des Sciences, Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie (l’ENCCRE)
[2] Friedrich Jakob, L'orgue, Payot, Lausanne, 1976
[3] Dotted Crotchet, The musical times and singing class circular, Vol. 42, n° 705, Nov. 1st, 1901, pp. 719-722.
MONSIEUR RÉ-DIÈZE ET MADEMOISELLE MI-BÉMOL
Un Conte de Noël de Jules Verne (1828 – 1905)
Publié dans Le Figaro Illustré de Noël 1893, n°45, pp. 221-28
Dans les textes ci-dessous, les phrases en italiques de couleur rouge foncé sont des citations du texte de Jules Verne.

Dans le bourg suisse de Kalfermatt, deux jeunes enfants, Joseph et sa chère amie Betty, dont « les voix se marient admirablement », appartiennent tous deux à la maîtrise d’enfants de l’église. Elle est dirigée par l’organiste Églisak, qui a « une tête en forme de contrebasse ». Ce dernier devenant sourd, les grandes orgues finissent par se taire six longs mois.
Pourtant, le 15 décembre, l’orgue se fait de nouveau entendre dans la bourgade. « C’était comme une tempête de sons qui en sortait. Les seize-pieds travaillaient à plein vent ; le gros nasard poussait des sonorités intenses ; même le trente-deux pieds, celui qui possède la note la plus grave, se mêlait à cet assourdissant concert… On eût dit que l’église n’était plus qu’un immense buffet d’orgues, avec son clocher comme bourdon, qui donnait des contre-fa fantastiques. »

Le vieil Églisak à l'orgue

Maître Effarane sortant de sa boîte les tuyaux des voix enfantines
Un Hongrois à l’aspect démoniaque, se disant accordeur et organier, flanqué de son valet et souffleur, homme trapu au « ventre en clef de fa », a pris possession de l’orgue. Prétendant s’appeler Maître Effarane, il convainc le curé qu’il va métamorphoser l’orgue de « vingt-quatre jeux, sans oublier le jeu des voix humaines » en y ajoutant un nouveau jeu, « le registre des voix enfantines ». Ainsi enrichi, l’orgue résonnera à Noël sous ses doigts.
Cet individu possède une boîte de flûtes de cristal, dont chacune doit donner la « note physiologique » qu’il s’applique à découvrir chez chaque enfant de la maîtrise, de façon à faire d’eux un « clavier vivant ». Le mi bémol est attribué à Betty, et le ré dièze à Joseph, notes identiques à l’orgue et pourtant séparées d’un comma, à la déception des enfants. Ainsi sont nés leurs surnoms ...
Le texte fait percevoir l’inquiétude grandissante de Joseph à qui la boîte aux voix enfantines fait l’effet « d’une cage pleine d’enfants que Maître Effarane élevait pour les faire chanter sous ses doigts d’organiste. »

Maître Effarane dirige les enfants vers les tuyaux...
Première et dernière page du manuscrit autographe de Jules Verne
© Ville de Nantes-Musée Jules Verne (photographie de Frank Pellois)
Sur la première page de son texte, Jules Verne a biffé « Un conte de Noël »…



La nouvelle de Jules Verne a été portée à l'écran par Jacques Trébouta et Robert Valey avec un téléfilm en noir et blanc, dont le titre est « L’orgue Fantastique ».
L’adaptation est de Claude Santelli qui a diffusé cette œuvre le 24 décembre 1968 sur la première chaîne de l’ORTF, pour la veillée de Noël.
Dans le film, les noms des personnages sont modifiés, sauf celui de Joseph. Eglisak devient Hartmann (Fernand Ledoux, à l'orgue historique d'Ebersmunster en Alsace), et Effarane est Takelbarth (Xavier Depraz). Claude Santelli résumait ainsi son interprétation du texte de J. Verne : « Les forces du Bien et du Mal s'opposent à travers deux conceptions de la musique ».
L'orgue fantastique
Jules Verne, né dans une famille musicienne, a reçu une solide éducation musicale. Comme son frère, il était pianiste. Féru de musique, il a écrit des chansons et a assidument fréquenté les cercles de musiciens.
La musique est très présente dans ses romans, beaucoup de ses personnages sont musiciens. Le plus célèbre est peut-être le capitaine Nemo de Vingt mille lieues sous les mers (1870) qui joue de son piano-orgue dans le Nautilus, la nuit seulement, une musique mélancolique et plaintive.

Jules Verne
9 février 1884
Photo d'Étienne Carjat
© Gallica

Le capitaine Nemo jouant la nuit dans le Nautilus
Vingt mille lieues sous les Mers,
Hetzel, 1871, p. 313
Illustration
de A.-M.-A. de Neuville
Pour en savoir plus sur Jules Verne et la place de la musique dans sa vie et dans son œuvre :
- France Musique, émission du 7 février 2021
- Dossier thématique "Jules Verne et la musique", site du Musée Jules Verne
NB. Les images en couleurs sont des illustrations du texte de Jules Verne publiées dans Le Figaro Illustré de 1893, et libres de droit.
ESTAMPES, MUSIQUE ET ORGUE



Un facteur d’orgues qui arbore un réchaud en tant que couvre-chef, sa femme coiffée et vêtue de tuyaux d’orgue… Un luthier portant un luth comme casquette, un facteur de trompette la tête dans le pavillon …Et tant d’autres artisans en tout genre, habilement affublés de leurs outils quotidiens ! Ainsi est constitué l’ensemble de quelques 190 gravures en couleur publiées, vers 1730, par l’éditeur et graveur Martin Engelbrecht (1684-1756), établi à Augsbourg. Fantaisie, humour et ingéniosité s’y conjuguent.




M. Engelbrecht est alors un acteur majeur à Augsbourg, ville franche du Saint Empire Romain Germanique. Prospère, cette ville est un important foyer artistique et l’un des principaux centres européens de publication de gravures ; les éditeurs exportent amplement à l’étranger, en particulier vers la France. Tant pour l’export, que pour s’adresser à l’élite éduquée non germanophone, M. Engelbrecht emploie la langue française en priorité devant l’allemand. Cela traduit le prestige culturel de la France.
Portrait de Martin Engelbrecht
par Philipp Andreas Kilian en 1742
Public domain, via Wikimedia Commons
Le titre français : « Assemblage nouveau des Manouvries habilles » (sic) précède donc le titre en allemand. Il est cependant est moins explicite que ce dernier (1), dont la traduction est : « Réunion récente d’artistes, artisans et de métiers habillés avec les outils propres à leurs métiers et artisanats ». De même, les légendes permettant de nommer les outils représentés sont données d’abord en français, puis en allemand, comme le montre le gros-plan ci-dessus.
(1) « Neu-eröffnete Samlung der mit ihren eigenen Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und Professionen »
La singularité de cette publication ne réside pas seulement dans le fait que les gravures, systématiquement en couleur, sont légendées en français et en allemand. Le plus original est, sans doute, que chaque métier est illustré par deux gravures, l’une consacrée à « Monsieur », l’autre à « Madame » dont l’attirail n’a rien à envier à celui de son époux. Aucun métier n’est considéré comme exclusivement masculin ou féminin.
Les historiens ont subodoré que M. Engelbrecht avait été influencé par les œuvres de deux graveurs français, les frères Larmessin (Nicolas 1er, 1632-1694 et Nicolas 2e, 1645-1725). Parues à Paris vers 1690 puis rééditées, connues sous le titre « Costumes grotesques », elles illustrent les divers métiers de la France sous Louis XIV avec des personnages composites faits, chacun, d’un assemblage des instruments emblématiques du métier dépeint. Les échanges constants des augsbourgeois avec la France, et les nombreuses contrefaçons de diverses gravures parisiennes réalisées à Augsbourg peuvent, en effet, le faire penser.
On estime que les créations des Larmessin ont été inspirées par les mascarades de la cour de Louis XIV, bals pour lesquels les participants revêtaient des costumes s’inspirant d’un univers familier, qui les métamorphosaient en êtres inattendus. Quant à la façon dont sont composés les personnages, elle relève de la manière d’Arcimboldo ce qui n’est, en revanche, pas flagrant chez M. Engelbrecht.
En outre, les Larmessin ne se sont pas spécifiquement intéressés aux métiers de l’orgue, ni même à ceux des autres instruments, mais seulement au « Musicien » constitué à lui seul d’un amalgame d’instruments de musique dont aucun n’évoque l’orgue. Ce n’est que dans une gravure préparatoire à la publication initiale de l’ouvrage, que Nicolas 1er use d’un petit orgue pour couronner la tête du musicien, ce dernier étant curieusement entouré du « Paticier » (sic) et du « Cuisinier », qui se tournent vers lui.


Nicolas 2e de Larmessin
Habit de musicien
Source gallica.bnf.fr / BnF
Nicolas Ier de Larmessin, Habit de Pâtissier, Habit de Musicien, Habit de Cuisinier, burin, 280 x 360 mm, vers 1687-1690 (?). BnF, Opéra, Rés-926 (11), fol. 35.
Les épreuves de ces gravures semblent constituer le premier jalon de la célèbre série des
Costumes grotesques. Pascale Cugy, 2020, http://journals.openedition.org/estampe/1416
Petite remarque finale : Karl Lagerfeld avait-il eu connaissance de la gravure de « La femme du facteur d’orgues » quand il a proposé pour Chanel, à l’automne-hiver 2008-2009 au Grand Palais, une collection inspirée des tuyaux d’orgues, dans un décor fait d’énormes tuyaux blancs ? Ou a-t-il été simplement motivé par son goût pour la musique d’orgue, associé à l’opportunité de réaliser des « tuyaux » qui, en couture, désignent des plis rigides et serrés, perpendiculaires au plan du tissu ?
Sources et précisions :
• Les gravures d'Engelbrecht sont dans le domaine public. La source est majoritairement la "Bayerische StaatsBibliothek". La gravure du facteur d'orgues vient du site de Bruxelles Ses Orgues. La taille des gravures est de l'ordre de 25 x 35 cm
• Article de Pascale Cugy cité ci-dessus
• Article de Philippe Poindront, https://www.persee.fr/doc/hista_0992-2059_2007_num_61_1_3198
• Mémoire de Acer Lewis, Martin's Engelbrecht Théatre de la milice étrangère, Vienne 2021
Merci à Michel Tissier d'avoir suscité la réalisation
de ce clin d'œil
LE FACTEUR D'ORGUE ALOYS MOOSER :
"L'HOMME AU CHIEN NOIR ET AUX MACARONS"
Dans la dixième des "Lettres d’un voyageur", George Sand relate la visite du trio romantique qu’elle forme avec Marie d’Agoult et Franz Liszt à l’église Saint-Nicolas de Fribourg en 1836, pour essayer le célèbre orgue dû à Aloys Mooser et achevé deux ans auparavant. La notoriété de Mooser, talentueux facteur d’orgue et de pianos-forte, est alors considérable.
Le jeu de Liszt magnifie l’orgue, et le musicien subjugue George Sand « … lorsque Franz posa librement ses mains sur le clavier, et nous fit entendre un fragment de son Dies irae [le Dies irae de Mozart] … nous comprîmes la supériorité de l’orgue de Fribourg sur tout ce que nous connaissions en ce genre … »
« Jamais le profil florentin de Franz ne s’était dessiné plus pâle et plus pur ... »

Grand-orgue de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, construit de 1829 à 1834, par A. Mooser qui en a réalisé le magnifique buffet néo-gothique. Cet instrument fut novateur tant par son remarquable jeu de Voix humaine que par le clavier d'Écho dont les jeux étaient placés sur le narthex. Il est devenu rapidement un des orgues les plus renommés d’Europe. En savoir plus.
Franz Liszt (1811 - 1886)
Compositeur et pianiste hongrois
Portrait réalisé par Henri Lehmann en 1839
Musée Carnavalet
Public domain, Via Wikimedia Commons

En revanche, l’attitude de Mooser, alors présent, ne bénéficie d’aucune indulgence sous la plume acérée de George Sand :
« Mooser, le vieux luthier, le créateur du grand instrument, aussi mystérieux, aussi triste, aussi maussade que l’homme au chien noir et aux macarons d’Hoffmann*, était debout à l’autre extrémité de la galerie, et nous regardait tour à tour d’un air sombre et méfiant. Homme spécial s’il en fut, Helvétien inébranlable, il semblait ne pas goûter le moins du monde le chant simple et sublime que notre grand artiste essayait sur l'orgue… »
* peu flatteur, sachant que cet homme, personnage du conte « La maison déserte » de E. T. A. Hoffmann, est ainsi dépeint par son auteur : « … un petit homme sec avec une face couleur de momie, un nez pointu, des lèvres pincées, des yeux de chat d’un vert étincelant, … »
.jpg)
Aloys Mooser
(1770 - 1839)
Le syndic (équivalent du maire) de Fribourg ayant expliqué aux visiteurs que A. Mooser doutait de la qualité de son orgue, ce qui pouvait expliquer son attitude rébarbative, G. Sand écrit : "
"Mooser n’est pas content de son oeuvre, et il a grand tort, je le jure ; car, s’il n’a pas encore atteint la perfection, il a fait du moins ce qui existe de plus parfait en son genre".

Franz Liszt au piano en 1840
Tableau de Josef Danhauser
Staatliche Museen zu Berlin
Au pied du piano, Marie d'Agoult
Dans le fauteuil : George Sand
A gauche de G. Sand : Alexandre Dumas
Les personnages debout sont (de g. à d.):
V. Hugo, N. Paganini et G. Rossini
Le buste de Beethoven trône sur le piano
Public domain, Wikimedia Commons
Les citations (en rouge) sont extraites de :
George Sand, Lettres d’un voyageur, Lettre X publiée le 15 novembre 1836 par la Revue des Deux-Mondes
E. T. A. Hoffmann, Contes nocturmes, La maison déserte (1817)

UN ORGUE AU CREUX D'UNE MAIN
Insolite, cet orgue qui se présente comme une main ouverte dirigée vers le ciel dans l’église Notre-Dame des Neiges à l’Alpe d’Huez ! Baptisé Christophe-Raphaël, il doit son existence au père Jaap Reuten, prêtre hollandais à l’origine de la construction, en 1968, de l’église dont l’architecture, conçue essentiellement par Jean Marol, est elle-même audacieuse, en forme de tente soutenue par une tour-clocher.
Souhaitant doter l’église d’un orgue résolument singulier, le père Reuten l’avait soudain imaginé avec une forme de main lors d’un geste de Jean Marol qui, bras tendu et main ouverte, prenait un repère*. Le facteur allemand Detlef Kleuker, contacté par le prêtre, sollicita Jean Guillou qui conçut l’instrument malgré bien des avis contraires. Jean Marol en dessina le buffet construit en bois de frêne. L’orgue fut placé dans le chœur de l’église, au pied d’un puits de lumière, destiné à être entouré des fidèles et des auditeurs assis dans la nef en gradins.
Cet orgue est « original en tous points, car la composition sonore l’est encore plus que le contenant », souligne Jean-Paul Imbert*, son organiste titulaire. Ce dernier a pris la succession de Jean Guillou en 1993 qui, après avoir inauguré l’orgue en décembre 1978, en fut le premier titulaire. J.-P. Imbert, et l’association Orgues et Montagnes dont il est le directeur artistique, organisent de nombreux concerts ainsi que des stages d’été pour les organistes, mettant ainsi en valeur les qualités de cet instrument.
* communication personnelle de Jean-Paul Imbert

Jean-Paul Imbert
à l'orgue de N.-D. des Neiges
© O. Tsocanakis
Jaap Reuten : 1929-1992 Jean Marol : 1930-2010
Detlef Kleuker : 1922-1988 Jean Guillou : 1930-2019

Vue du chœur et de l'orgue de N.-D. des Neiges depuis le haut de la nef en gradins, avec le puits de lumière qui se détache de la charpente en bois
Crédit : jyhem. Source : Flickr / Creative Commons

L'orgue de N.-D. des Neiges,
volets de la boîte expressive ouverts
© É. Bardez
L'instrument
2 claviers de 61 notes (grand-orgue, récit expressif), pédalier de 32 notes,
24 jeux dont deux en chamade (à gauche l'intégralité du hautbois 8 du récit, rajouté en 1987 ; à droite, trompette 8 du grand-orgue, au-dessus du 2e fa dièse), combinateur électronique.
Détail de la composition: Inventaire des orgues
Les quatre doigts du haut de la main sont les tuyaux en bois de la flûte de 16 pieds du pédalier, les plus grands étant situés à l'arrière de l'instrument. Le pouce est le buffet d'une partie des tuyaux des jeux du grand-orgue. Les tuyaux visibles de la gauche de la paume appartiennent à la montre 8 du clavier du grand-orgue. À droite de la paume, les tuyaux placés derrière les volets de la boîte expressive sont ceux du clavier du récit ; les volets s’ouvrent et se ferment pour faire varier l’intensité sonore des jeux concernés.
"Sur la façade latérale gauche [non visible sur la photo], se trouvent les tuyaux de la magnifique flûte des neiges du clavier de grand-orgue" (J.-P. Imbert)

La console. © É. Bardez

En chamade : jeux de hautbois (à g. sur la photo) et de trompette (à d.)
Boîte expressive ouverte sur la droite
© É. Bardez
Pour en savoir plus :
• Site de Jean-Paul Imbert (avec les vidéos associées)
• Site Jean Guillou (géré par AUGURE)
• Site de l'association Orgues et Montagnes
• Jean Guillou, L’Orgue, Souvenir et avenir (Buchet-Chastel, 1978 ; puis diverses rééditions augmentées jusqu’en 2010)
L'ORGUE DU STADE ou L'ORGUE, DIEU DES STADES ?

© Tangopasso via Wikimedia Commons

© É. Bardez
© Auteur inconnu via Wikimedia Commons

© É. Bardez
ANDRÉ OBEY, écrivain, mais aussi pianiste talentueux et athlète accompli, était habité par un souvenir apaisant de l'école de son enfance, à l'origine de son essai de 1924 :
L'ORGUE DU STADE
"La même vision, chaque soir, me sauvait de l'enlisement : c'était, sur un rayon, la série des mesures d'étain –centilitre, double-centilitre, demi-décilitre...–
un petit orgue à sept tuyaux,
musicien du silence."
Lorsqu'il assiste aux épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Paris en 1924, imprégné de ce souvenir, il associe les "sept courses classiques : Cent, Deux cents, Quatre cents, Huit cents, Quinze cents, Trois mille, Cinq mille [mètres]" à "sept sons purs" émis par "sept tuyaux, inégaux et semblables" qui "chantent leur gamme de timbres : Hautbois, flûte, clarinette, voix humaine, trompette, cor et basson", "une symphonie de certitude [qui] émane de l'orgue".

© É. Bardez
Ce texte doit être compris dans le contexte de glorification du sport propre à l'entre-deux-guerres, et en prenant en compte l'amour de A. Obey pour la musique. La même année (1924), il écrit :
"Quant au sport, au cœur du sport, à l'athlétisme, je vous jure qu'il est musical, mieux, qu'il est musique"
(“D'un art sportif", L'Impartial français, Paris, 15-11-1924, p. 13)

Pour en savoir plus sur André Obey (1892-1975), né à Douai, poète, écrivain, dramaturge sous l'impulsion de Jacques Copeau, et connu pour sa participation à la Compagnie des Quinze créée dans la continuité de la troupe des "Copiaus" (1931-1935), suivre ce lien.
.jpg)
André Obey
© Avec l'aimable autorisation de la bibliothèque
Marceline Desbordes-Valmore (Douai) - Ms 1852-95-1
L'ORGUE, DIEU DES STADES AMÉRICAINS
La plupart des clubs de base-ball, de basket et de hockey sur glace aux États-Unis (et au Canada) ont leur organiste attitré, qui accompagne les matchs sur un orgue numérique placé en haut des tribunes, souvent en improvisant (France Musique, 12 janvier 2021)
Citons l'organiste du club de base-ball, les New York Yankees : Ed Alstrom, qui depuis plus de 20 ans a succédé au légendaire Eddie Layton (1925 - 2004). Il joue au Yankee Stadium de New York (Bronx) les samedis et dimanches.
Le dimanche, il joue le matin à l'église et l'après-midi au stade sur un orgue Hammond.
Curiosité : il pratique le pédalier en chaussettes, celles du club : les Yankees Socks !

Photo de Ed Alstrom projetée sur le tableau d'affichage du Yankee Stadium pendant un match de base-ball
© Creative Commons CC0
Le base-ball ne sera pas présent aux J. O. de Paris cette année, alors qu'il était à Tokyo en 2021. Il faudra attendre la prochaine édition des Jeux en 2028 à Los Angeles pour le retrouver.

PAUL ET GERTRUD HINDEMITH RÉUNIS À L'ORGUE

© Avec l'aimable autorisation de la Fondation Hindemith de Blonay
Fonds Kokoschka 330.28 Zentralbibliothek Zürich
Paul Hindemith (1895 - 1963), compositeur et instrumentiste, est également un dessinateur de talent et un caricaturiste. Dans ses innombrables caricatures, il a pour habitude de représenter Gertrud, la compagne unique et l'amour de sa vie, sous forme d'un lion, signe du zodiaque de cette dernière.
La carte de Noël 1963, et de vœux pour 1964, qu'il a dessinée comme chaque année, est la dernière. Gertrud fournit à Paul le souffle indispensable à son épanouissement dans la musique. Cette carte est particulièrement émouvante quand on sait que son auteur décède brutalement le 28 décembre 1963.

Paul Hindemith et Gertrud en 1924, année de leur mariage. Fille de L. Rottenberg, chef d'orchestre de l'Opéra de Francfort, elle est chanteuse et violoncelliste amateur. Paul et Gertrud partagent leur passion pour la musique.
© Avec l'aimable autorisation de la Fondation Hindemith de Blonay
Michel Tissier a interprété la Sonate pour orgue n°2 de Paul Hindemith
le mercredi 24 juillet 2024, à l'orgue de Notre-Dame de Beaune
Les personnes intéressées par la biographie et par diverses informations sur Paul Hindemith sont invitées à se rendre sur le site de la fondation Hindemith.
HARMONIE DU MONDE NAISSANT
gravure extraite de Musurgia Universalis, vaste traité sur la musique baroque de Athanasius Kircher (1650)
T. 2, livre X, p 366

Source : IMSLP (Petrucci music Library)
Cette gravure est une des illustrations de l'article :"La symbolique des nombres dans l'œuvre de Bach" de Esther Assuied publié sur le site de Orgue en France
